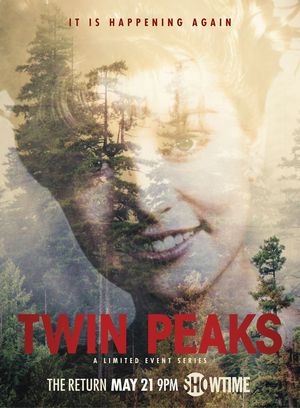Le secret des films de Lynch, c’est qu’il n’y a pas de secret. Le principe de ses films s’offre à nous avec une simplicité tellement évidente qu’on ne peut que passer à côté. Une fois découvert ce principe, alors le film s’éclaire, et on n’a plus qu’à admirer comment ce positionnement dans le premier degré autorise toute une liberté ; car la mise en scène, libérée de sa nécessité de « devoir dire », de « symboliser », de « signifier », peut alors exprimer véritablement les délires anxiogènes de son auteur, sans aucune arrière-pensée, dans une simplicité et un dénuement presque obscène.
Quel est donc le principe de cette troisième saison de Twin Peaks ? Il s’offre à nous dès les premières minutes, lors du dialogue initial entre le géant et Dale Cooper. Le géant dit à Dale Cooper : « Listen to the sounds. » Il y a alors un plan sur un phonographe émettant ce qui semble être des bruits de grattement. Puis Dale Cooper dit : « I understand. » Pourquoi chercher plus loin ? Twin Peaks sera une série à écouter. Quiconque passe à côté de cette mise en garde ne pourra que se sentir déboussolé, désorienté, perdu, dans les scènes qui suivront. Car cette troisième saison se situe bien moins dans la continuité des deux autres que dans celle de son dernier film, Inland Empire. On assiste à une succession de scènes apparemment aléatoires, dont le lien logique se fait difficilement sentir, voire même est quasiment inaccessible. Si l’on ajoute à cela les visions toujours plus délirantes, dont certaines n’hésitent pas à flirter avec le kitsch le plus ostentatoire, on a là un nouveau labyrinthe dont seul Lynch a le secret, et aux côtés duquel les précédents semblent dérisoires. En sorte que cette série, qui aura tout de même dix-huit épisodes, risque d’être très éprouvante pour celui qui sera passé à côté de la mise en garde initiale.
Pour les autres, il n’y a plus qu’à se laisser porter ; ou plutôt, il n’y a plus qu’à écouter. Car la prédiction du géant s’avère être exacte. Cette troisième saison s’annonce comme une odyssée du bruit. C’est presque comme si la série avait été pensée pour cela. On retrouve évidemment les sonorités graves d’Angelo Badalamenti, mais vont venir s’ajouter toute une myriade d’autres sons, électroniques, organiques, synthétiques, terrifiants, comiques, tout un tas d’atmosphère aussi, qui interviendront parfois directement dans la mise en scène, au point de déterminer les évènements. Le son est véritablement ce qui véhicule le sens des scènes ; on peut douter sur les évènements particuliers, sur certains dialogues, sur certaines situations, mais le son ne nous trompe absolument jamais sur l’émotion qui doit être ressentie dans tous ces évènements particuliers, dialogues, etc. Le son est le support du sens, du sens véritable ; et c’est là que l’on comprend sa fonction : c’est que ce sens se ressent plus qu’il ne se dit ("Tout ne peut être dit à haute voix maintenant" dit même le géant); le son permet de jouer sur la composante fondamentale de l’expérience du spectateur : l’affect. Ainsi, le « faites confiance au son » pourrait se traduire par un « faites confiance à vos affects ». On rejoint encore une fois ce principe de littéralité qui caractérise le cinéma de Lynch : point d’intellectualisation, la vérité est non pas dans le discours, non pas dans l’interprétation que vous tenterez de faire, mais bel et bien dans votre émotion ; dans ce que vous ressentez en premier lieu.
Envisager la série sur cette base permet d’adopter une certaine sérénité. On est en quelque sorte prévenu : il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. Dès lors, on peut se laisser bercer par le ronronnement de la série, par les scènes toujours plus insolites qui se succèdent, et prendre son mal en patience : on comprendra plus tard. Pour l’heure, prenons les évènements tels qu’ils nous viennent, prenons-les, encore une fois, dans leur littéralité, sans chercher à déterrer un « sens caché » ; faisons comme le détective Auguste Dupin dans la Lettre volée, et trouvons la solution là où elle a toujours été : sous nos yeux.
Ces prémisses une fois posées, on peut plonger dans la série. Cependant, à l’heure où nous écrivons, seuls quatre épisodes ont été diffusés. Ce que je me propose donc de faire, c’est d’essayer de voir, sur la base de ces débuts, vers où la série semble se diriger ; quelles peuvent être nos attentes. Puis, une fois la série terminée, on reviendra là-dessus, et on verra alors comment les choses ont évolué.
Après quatre épisodes, donc, la série semble s’installer ; une narration prend forme ; mais c’est presque avec réticence. Tout se passe comme si Lynch reculait le plus possible le moment où il aura à construire une certaine continuité, tant les premiers épisodes sont d’un éclatement et d’une disparité jubilatoire. On est plus dans une accumulation de saynètes, et c’est presque par accident si certaines résonnent entre elles. On semble alors suivre le chemin inverse des films de Lynch : alors que ceux-ci commençaient de manière toujours très claire, la narration s’éclatait au fur et à mesure ; ici, au contraire, la narration est d’emblée éclatée, puis peu à peu, cahin-caha, des lignes sont tracées, une continuité s’instaure, et l’histoire prend forme. On pourrait dire que c’est presque une sorte de mise à l’épreuve : ceux qui ont passé les deux premiers épisodes, qui n’offrent strictement aucun repère, peuvent alors assister à la mise en place de ce qui fera office d’intrigue.
On peut brièvement résumer cette intrigue. Le doppelganger de Dale Cooper est en sursis : bientôt, il devra rejoindre la Black Lodge. Mais il n’en a pas la moindre envie ; il élabore alors un plan pour y échapper. Pendant ce temps, le vrai Dale Cooper, emprisonné dans la Red Room, est à la recherche de son double, avec qui il devra échanger sa place. Mais il semble qu’il se trompe de double, et qu’il expédie dans la Red Room un double artificiel, sans doute fabriqué par le doppelganger. Dale Cooper et son doppelganger sont donc tous les deux dans le monde réel ; il faudra fatalement que l’un des deux meure.
Autour de cette trame, une multiplicité d’intrigues prennent place, comme autant d’embryons ; un peu à la manière d’Inland Empire, où une sitcom avec des lapins alternait avec des mafieux russes mystérieux. Ici, on a un meurtre épouvantable, une étrange créature apparaissant dans un cube en verre, un gérant de casino terrifié par son patron, etc. Et à travers tout ça, parce qu’on allait presque l’oublier, il y a la ville de Twin Peaks, dont nous retrouvons peu à peu les habitants. Pour l’instant, l’intrigue se résume à l’adjudant Hawks qui cherche à comprendre le message de la femme à la bûche ; les scènes avec les autres personnages de la ville sont encore sous la forme de saynètes juxtaposées.
On est donc en plein terrain d’expérimentation lynchien – et ce, pour notre plus grand bonheur. La forme-série semble être la forme idéale pour laisser libre les idées folles du maître ; pour leur laisser le temps de leur plein accomplissement. Le grand metteur en scène n’a plus rien à prouver, aussi se laisse-t-il aller toujours plus loin dans les limites de son imagination (je pense particulièrement au début de l’épisode 3). C’est donc à la fois une continuité et une rupture. Lynch reprend les thèmes qui lui sont cher, qui traverse toute son œuvre, et pousse à fond les curseurs, libérant sa puissance créative à un degré jamais atteint.
On a déjà parlé de la narration, mais il faut redire à quel point elle est retravaillée. Auparavant, Lynch jouait le jeu : il maintenait le rythme, il annonçait qu’il allait suivre les canons de la narration classique, avant de savamment les tordre, les retourner. Depuis Inland Empire, cette préoccupation a purement et simplement disparu. Désormais, on se trouve dans son jeu à lui, avec ses propres règles. Ce qui n’était alors qu’à l’état d’embryon dans ses précédents films devient ici un principe directeur. A savoir que les moments de flottement, les moments de relâchement, où rien ne semble se passer, où l’on progresse par à-coups, par accidents, qui n’étaient que des moments d’exception dans Mulholland Drive, par exemple (les histoires périphériques à celle de Diane/Rita), deviennent ici la norme. Les temps de latence sont exacerbées ; on ne sait pas où commence véritablement la scène, ni quand elle se finit ; on laisse le temps s’installer, et on voit ce qu’il se passe ; on attend l’accident. Alors ces accidents se produisent, on attend encore un peu (deux ou trois épisodes), et enfin on comprend que ces accidents organisent quelque chose ; ce sera l’histoire.
Un autre thème de David Lynch est sa relation à l’organicité ; aux substances visqueuses et répugnantes. C’était l’oreille de Blue Velvet, le vomi de Sailor et Lula ; c’était la transformation sanglante de Fred Madison en Pete Dayton dans Lost Highway ; etc. A chaque fois, ces occurrences étaient comme une tâche dans le plan. Tout était si lisse, si propre, et voilà que quelque chose venait salir ce cadre aseptisé ; mieux, venait éclabousser (en tout cas dans Lost Highway), mais dans un éclair, dans un instant considérablement restreint, qui ne faisait qu’accroître le choc éprouvé à sa vision, qui venait éclabousser, donc, ce cadre qui se voulait si propre sur lui. Ici, dans cette troisième saison, ce principe est repris au carré. Les scènes « gore » sont beaucoup plus fréquentes, mais Lynch a gardé tout ce qui était au principe de leur efficacité cauchemardesque : leur instantanéité, leur surgissement, et leur évanescence ; tout se passe si vite, et c’en est presque plus traumatique. On pense ici, bien évidemment, à la scène d’horreur de l’épisode 1, avec les deux jeunes en flirt devant le mystérieux cube de verre. Mais il y a également tout un tas d’autres apparitions (le « bras » du manchot, un morceau de chair dans une voiture, un cadavre épouvantable), qui ponctuent la série de touches d’horreur.
La terreur était aussi un grand thème lynchien, sinon le thème lynchien. Comment vivre avec la peur, comment vivre avec ses monstres ? D’où vient la peur, quels sont ses effets ? Ce thème était indissociable de la dualité du montré et du caché. Comment ce qui est caché resurgit dans ce qui est montré, comment ceux qui vivent dans le monde « montré », dans le monde évident, avec de belles couleurs, ne peuvent alors que redouter que ce qui est caché resurgisse dans leur monde à eux, et comment, alors, ce qui est caché infuse dans le premier monde, l’empoisonnant. Le montré et le caché est au principe de quasiment tous les films de Lynch : Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive, et… Twin Peaks, évidemment. Ce qui est montré, c’est la banalité du quotidien, la normalité de surface dans laquelle vivent les classes moyennes américaines (Lost Highway), ou les habitants des petites villes sans histoires (Twin Peaks). Ce qui est caché, ce sont tous les désirs refoulés, les choses que l’on jette sous le tapis pour ne pas entacher le vernis, tout ce qui ne doit pas bousculer cette quotidienneté. L’originalité chez Lynch, car, on en conviendra, ce thème des secrets obscurs de la petite-bourgeoisie est finalement plus qu’un lieu commun, l’originalité, donc, chez Lynch, consiste en ceci que cette dualité du montré et du caché n’a pas grand-chose à voir avec le thème de l’hypocrisie. On n’est pas chez Chabrol, ou chez Buñuel. Ici, chez Lynch, les secrets que l’on refoule sont des secrets véritablement terribles, et, s’ils sont certes de la propre production de ceux qui les refoulent, c’est plus par instinct de survie qu’ils agissent comme tel que par véritable hypocrisie. Car ce qui est refoulé n’est pas du même ordre que ce qui peut l’être chez Chabrol ou chez Buñuel ; ou plutôt, si, par exemple dans Twin Peaks, on peut avoir certaines choses de cet ordre-là (les tromperies, les manigances, etc.), il s’avère très vite qu’il y a quelque chose d’encore plus fondamental à refouler, et là, par contre, on est bel et bien dans la survie. Ce qui est à refouler, c’est la pulsion, la pulsion sexuelle, la pulsion de meurtre, la pulsion destructrice et mauvaise, qui répand terreur et désolation. C’est cela qu’est Bob dans Twin Peaks. En outre, il ne faut pas oublier le principe de la lettre volée exposé plus haut ; en sorte que le caché n'est jamais aussi bien caché que lorsqu'il est sous nos yeux ; et de fait, Bob n'était-il pas sous nos yeux depuis le début, puisqu'il était... Leland Palmer ?
L’autre originalité de Lynch, c’est que l’objectivation de ces pulsions en des personnages tels que Bob, amenait à une autonomisation de ces mêmes personnages, qui de ce fait ne pouvaient plus être pris sous le seul rapport du symbole. Bob est un personnage à part entière, avec sa psychologie propre ; et si il peut certes exprimer quelque chose des désirs enfouis de la ville de Twin Peaks, ou de ceux du père de Laura Palmer, il n’en reste pas moins qu’il est « plus » que ça ; il est un habitant de la Black Lodge, qui elle-même est « plus » qu’un simple symbole. Par-là, Lynch crée des créatures qui, si elles ont un font de rationnel, une origine qui est tout à fait saisissable, finissent tout de même par échapper à cette rationalité, et peuvent alors incarner la peur à l’état pur (ce qu’est Bob). On entre alors dans le pur domaine lynchien, décrit plus haut : le domaine de la littéralité, où les personnages ne sont et ne signifient rien d’autre que ce qu’ils sont ; Bob « quitte » ses habits de symbole et devient ni plus ni moins que la peur elle-même ; pas de manière abstraite, mais de manière concrète ; la peur, c’est Bob, Bob, c’est la peur ; ni plus, ni moins. On pourrait presque dire, alors, qu’en réalité, Bob n’est pas « plus » qu’un symbole, mais « moins » qu’un symbole ; sa littéralité le situe au seuil du symbolisme, et c’est de cette manière qu’il prend vie.
Cette terreur se retrouve dans cette troisième saison de Twin Peaks ; en tout cas dans les deux premiers épisodes. La narration éclatée, la non-narration, crée immanquablement le malaise, ou « l’inquiétante étrangeté ». Tout l’enjeu est alors de capter la transformation du malaise en terreur. Comment celle-ci surgit, limpide, avant de disparaître tout aussi abruptement. On n’a pas quitté la classe moyenne et son aspérité de surface. Seulement, on semble prendre pour acquis, maintenant, ce qui auparavant nécessitait un dévoilement. On sait que ça n’est qu’une surface, et, si on continue de montrer de belles couleurs et de belles cuisines, ça n’est finalement que par convention. Le malaise est plus que palpable. D’ailleurs, les plus belles terreurs de cette début de série ne viennent pas vraiment de cet environnement-là ; elles nous viennent de lieux qui sont immédiatement identifiées comme purement lynchiens : c’est cette pièce avec la cage en verre, ou encore, évidemment, la Red Room. On ne semble plus être dans une dialectique du caché et du montré (ou alors, sur une toute autre modalité, dont il sera intéressant de voir l'évolution), mais il semble qu’il y ait encore des figures qui incarnent à elles seules, à la manière de Bob, tout un concentré d’horreur pure (la créature de la cage en verre).
Ce qui est vraiment nouveau, par contre, c’est l’humour. Lynch a toujours eu une fibre humoristique, et rares sont ses films sans scènes de pure comédie ; mais ça restait malgré tout assez marginal. Il semble qu’il ait trouvé là, dans cette troisième saison, un terrain de jeu à sa mesure, qui le laisse pleinement libre d’expérimenter ses talents de metteur en scène de comédie. L’humour chez Lynch, était toujours une sorte de contrepoids à la terreur ambiante. C’était presque un opposé dialectique, tant les deux, l’humour et la peur, peuvent être vus comme s’engendrant réciproquement. C’est que Lynch nourrit une fibre surréaliste ; c’est sur cette corde qu’il joue lorsqu’il veut provoquer la peur ; et c’est tout naturellement sur cette même corde qu’il va jouer lorsqu’il faudra provoquer le rire ; c’est pour cela que nous disons que les deux s’engendrent réciproquement, car ils ont la même origine : « l’inquiétante étrangeté ». Les deux derniers épisodes sortis, le 3 et le 4, développent vraiment cette fibre-là, et il est réjouissant de voir un cinéaste autant s’amuser ; de le voir s'autoriser ce que jusque là il ne réservait qu'à de rares et courtes scènes.
Mais peut-être peut-on dire qu’il y a un élément vraiment nouveau dans cette mise en avant de la comédie : c’est l’autodérision. Deux scènes sont significatives. La première est avec Hawks ; il a reçu le coup de fil de la femme à la bûche qui lui a dit que « quelque chose manquait » qui avait à voir avec l’agent Dale Cooper et son héritage. Hawks, très consciencieux, ressort alors le dossier Laura Palmer, et entreprend de faire un inventaire exhaustif des pièces de ce dossier. Andy et Lucy l’aident. C’est alors que Lucy pousse un cri : elle vient de voir qu’il manquait un lapin au chocolat dans une boite ; elle avoue : c’est elle qui l’a pris ; se pourrait-il que ce « quelque chose qui manque » ait un quelconque rapport avec cela ? On est alors en plein situation lynchéenne de déchiffrement de l’incongru ; tout objet, dans l’univers lynchien, peut avoir une signification ; ici, ce principe se trouve poussé à l’absurde ; et l’on voit alors ce pauvre Hawks se demander si l’indice donné par la femme à la bûche peut avoir quelque chose à voir avec un pauvre lapin au chocolat. L’absurde de la situation est tellement mis en avant qu’on ne peut s’empêcher de penser qu’ici Lynch se moque de lui-même, et de sa manie à faire de n’importe quel objet un vecteur de sens, un signe à déchiffrer. Plus loin, un gag reposant sur le même principe se produit : une série d’objets appartenant à un tueur est étalé devant le directeur du FBI Gordon Cole (David Lynch lui-même), d’une nature extrêmement disparate les uns avec les autres. La caméra les parcourt lentement, et l’on ne peut s’empêcher de penser à une sorte de rébus que formeraient tous ces objets ; un autre message à déchiffrer. Cole se lève alors subitement, et demande à ses subalternes de plancher sur le sujet ! On a alors, dans un premier temps, une nouvelle fois une autodérision sur cette manie du message codé, du rébus à déchiffrer, résolu, dans un second temps, par une fuite, par un « je m’en foutisme » de la part de celui-là même qui a créé ce rébus, David Lynch. Et, si cette voie vers l’autodérision n’était pas manifeste, il y a enfin cette scène qui clôt l’épisode 4, où Gordon Cole-David Lynch avoue à son acolyte Albert : « Ça me fait mal de l’admettre, mais je ne comprends rien à cette situation. »
Mais quel serait le thème central ? On ne peut être sûr de rien, mais il se pourrait, sur la base de ce que nous proposent ces quatre premiers épisodes, que le thème qui semble lier entre elles toutes les scènes, et être le fil souterrain de tous les innombrables fils qui ne manqueront pas de parsemer la série, est le thème du temps ; mais non du temps abstrait, ou du temps à la Tarkovski, qui constitue une expérience ; mais plutôt le temps qui passe, qui change les individus et les choses, et qui s’éprouve par le biais du souvenir. Nous pensons ici à une scène aussi imprévue qu’émouvante ; Bobby Briggs tombe subitement sur la photo de Laura Palmer, sortie par Hawks dans le cadre de ses investigations. L’émotion surgit alors, aussi instantanée qu’intense, submerge Bobby, et nous, par la même occasion ; le vieux thème tant entendue de la série s’enclanche ; et Bobby exprime alors clairement ce que nous ressentions, depuis le début de la série en général, et dans cette scène en particulier : « It brings back some memories ». L’émotion est si limpide, si spontanée, si sincère, l’effet « madeleine de Proust » est si évident, si appuyé, qu’il n’est pas superflu de penser que l’on tient là le véritable thème de cette saison 3.
Car elles sont nombreuses ces scènes qui jouent sur le souvenir, la nostalgie que l’on peut éprouver à retrouver des vieilles connaissances, à les reconnaître malgré leurs traits qui ont changé, qui ont vieilli, et à apprécier ainsi le temps passé, marqué à même les rides de ces visages qui autrefois furent jeunes. Pour l’instant, nos vieilles connaissances de Twin Peaks semblent patienter dans cette antichambre de la narration que semble être le bar « Bang Bang » ; on y voit ainsi Shelly Johnson, James Hurley, et d’autres encore, qui n’ont pas encore d’intrigues qui leur soient propres, mais qui semblent patienter en attendant ; la promesse est là, de toute façon ; on les retrouvera.
David Lynch serait-il à la recherche du temps perdu ? Non pas de manière proustienne, évidemment, mais d’une manière qui lui appartienne bel et bien en propre. La question qui sous-tend ces quatre premiers épisodes, et qui semble partie pour soutenir tous les autres, pourrait bien être : « que s’est-il passé pendant 25 ans ? ». Le monde a bien changé ; de nouvelles technologies sont apparues (Lucy ne se remet toujours pas de l'arrivée du téléphone portable), de nouveaux lieux, de nouvelles habitudes… Finalement, il se pourrait bien que le premier à être perdu dans ce monde étrange, ce soit David Lynch lui-même ; et sa phrase qui clôt l’épisode 4 (« Ça me fait mal de l’admettre, mais je ne comprends rien à cette situation. ») pourrait bien être plus qu’un aveu comique ; un aveu à la fois triste et lucide, que le réalisateur préfère tourner en dérision, mais qui n’en est cependant pas moins dénué de gravité.
Twin Peaks serait alors le seul lieu stable, le seul référent dans ce monde sans repère. C’est qu’on y a quelque chose là-bas, qui nous y rattache : on y a, encore et toujours, un affect. On a suivi la vie de la ville sur de nombreux épisodes, c’est presque comme si on y avait habité nous-même ; elle nous est familière ; bien plus, en tout cas, que ces immeubles immenses ou ces casinos lumineux. Ce serait en quelque sorte un refuge, face à ce monde incompréhensible qui a remplacé le vieux monde. Il se pourrait que la série trouve là une matière dans ce contraste : contraste entre le lieu chargé de souvenirs qu’est Twin Peaks, et les autres lieux, sans souvenirs, anonymes, inquiétants, qui parsèment la série. La petite ville de montagne pourrait alors être un lieu centralisateur, qui pallierait à la désorientation occasionnée par la prolifération de géographies, d'intrigues, de personnages ; un lieu connu dans un monde inconnu. Face au monde (post ?) moderne disparate, fragmenté, et technologique, qui s’est transformé à une vitesse folle, on pourra se retrouver à Twin Peaks, avec des personnages qui eux aussi ont changé, avec aussi, il ne faut pas l'oublier, ses propres terreurs, ses propres démons, mais qui tous, démons et amis, nous sont familiers.
A l'appui de ce propos, il y a cette scène hallucinante, dans le casino, avec Dale Cooper qui dérègle toutes les machines. D'abord, il y a Dale Cooper, sorti tout droit de la Red Room, et qui semble, par effet d'inertie, avoir importé dans le monde réel toutes les poses hiératiques, ataviques, mutiques, qu'il pouvait avoir dans la Red Room ; ces attitudes avaient un sens dans cette dernière, où le temps y était comme au ralenti ; mais dans le monde réel, cela place Dale Cooper en constant décalage. Il passe d'un monde où manifestement il avait fini par s'adapter, jusqu'à adopter un nouveau comportement, d'un monde qu'il connaissait, donc, à un monde nouveau, complètement nouveau, qu'il ne connaît pas. Le confrontation du connu et de l'inconnu se manifeste alors encore une fois de par le principe de littéralité cher à Lynch, le principe d'un premier degré radical, puisque Cooper est littéralement en décalage vis-à-vis du monde inconnu ; ses attitudes ne correspondent pas.
Mais il y a aussi ce moment particulier où les machines à sous tout à coup se dérèglent. Car qu'est-ce qui les dérègle, ces machines ? N'est-ce pas ces apparitions mystérieuses de... la Red Room au-dessus des machines ? N'est-ce pas l'apparition de quelque chose que nous connaissons (la Red Room) dans quelque chose que nous ne connaissons pas (le casino) ? Quelque chose qui serait comme une présence malicieuse, et qui, du fait que nous la connaissons, autorise une complicité avec cette présence, et rend d'autant plus réjouissante le dérèglement de cet environnement anonyme et imposant qu'est le casino ; nous implique dans ce dérèglement, nous en fait un complice. On pourrait avoir, là encore, une confrontation entre le connu et l'inconnu, le familier et le post-moderne. Peut-être est-ce un avant-goût, pour l'instant comique, d'une lutte qui se prolongera tout au long de la série ; et peut-être cet avant-goût prendra-t-il alors une tournure tragique (car l'iPhone brandi par le shérif Truman, et qui cause tant d'émois à Lucy, n'a-t-il pas déjà quelque chose de tragique ? Quelque chose qui ne serait pas à sa place et qui menacerait en quelque sorte l'intégrité de ce lieu qu'est Twin Peaks ; ou plutôt, l'intégrité du souvenir que l'on a de ce lieu, puisque, d'aussi loin que remontent nos souvenirs, il n'y a jamais eu d'iPhone à Twin Peaks).
On reviendra, à la fin de la série, sur ces fils que nous avons cru déceler dans ce début de série. On mesurera alors si nos attentes ont été déçues, remplies, ou déjouées. Car ce que nous avons dit ne peut être que de l’ordre de la conjecture ; il faudra que cela se vérifie par la suite ; nous ne prétendons pas anticiper sur la série ; simplement, poser une première étape, expliciter tout de suite certaines choses, afin de mieux plonger dans la suite de cette troisième saison, qui s’annonce particulièrement touffue et labyrinthique ; afin d’avoir quelques points de repère initiaux qui nous permettront de mieux nous perdre dans la suite de la saison. Saison qui s’annonce, d’ores et déjà, absolument passionnante.