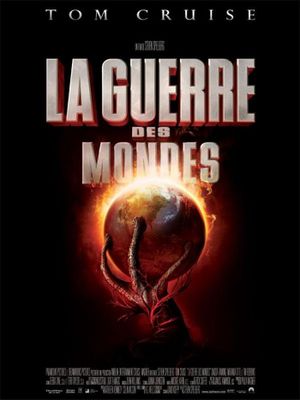Possible définition d’une catastrophe historique : surgissement à la surface des événements d’une fleur, s’apparentant à une bombe à retardement, dont l’éclosion (et l’explosion) dans le présent plonge ses racines (sa mèche) dans un passé fertile et fortement sédimenté où chaque couche traversée ajoute à la charge de départ.
On récolte ce que l’on sème, dit-on. La métaphore n’est pas nouvelle chez Spielberg. Déjà dans Amistad, il faisait de l’ex-président Quincy Adams, sur lequel il projetait l’idéal des pères fondateurs de la nation américaine, un jardinier prenant soin de faire germer dans l’esprit de ses contemporains l’idée d’achever le travail de ses ancêtres en anéantissant l’esclavage. Et dernièrement encore, dans Lincoln, il faisait dire à son sage et facétieux « Abe » tout occupé à transformer l’essai d’Adams : « Si vous pouvez, en regardant les semences du temps, trouver quelle graine germera et laquelle ne germera pas, alors instruisez-moi ». Et, de fait, il y a d’autres types de graines que les États-Unis, en mode apprentis sorciers, ont semés, et qu’aux premières heures du XXIe siècle ils ont récoltés de plein fouet.
Il faut cultiver son jardin
Que Steven Spielberg et ses scénaristes David Koepp et Josh Friedman aient choisi de faire sortir leurs tripodes des entrailles du « jardin » américain plutôt que de les faire venir par les cieux depuis l’étranger est tout sauf anodin. Parce qu’on ne déterre jamais quelque chose en vain. Parce qu’au cinéma, exhumer, c’est souvent faire refluer quelque chose de mal digéré. Les soldats du J’accuse d’Abel Gance, les zombies de George A. Romero, ou plus récemment ceux de Joe Dante dans Vote ou Crève (Masters of Horror, saison 1, épisode 6) en sont les preuves (mort-)vivantes). Et les tripodes de La Guerre des Mondes sont faits de ce même bois, revenant, hantant, assoiffé de sang.
Historiquement et culturellement, il y a aux États-Unis une certaine tendance à penser le territoire comme une sorte de sanctuaire (l’ « espace » mental de la claustrophobe Rachel), de domaine quasi-sacré (l’église de sous laquelle émerge la première machine), une île à l’abri du monde extérieur (« … c’est des terroristes ? », « Non c’est…, c’est quelque chose qui vient d’ailleurs »). Bordés par deux océans au levant et au couchant, voisins d’un allié au nord et d‘un vassal au sud, les États-Unis, contrairement à tous les pays d’Europe, n’avaient jamais - et n’ont toujours pas - réellement connu d’invasion. Car les murailles de la forteresse puritaine étaient solides, et la « doctrine Monroe », en faisant de l’entier continent américain le terrain de chasse gardée d’Uncle Sam, avait creusé de profondes douves autour d’elle. Le « mal », dont on pensait qu’il ne pouvait venir que du dehors, y était ainsi contenu. Et si, à deux reprises (lors des guerres d’indépendance et de 1812), les Anglais avaient bel est bien débarqué - drôles d’envahisseurs que ses frères de la métropole -, ils avaient été refoulés, comme l’histoire précoloniale de cette « terre d’élection » qui, s’imaginait-on, était restée vierge (1).
Autant dire que pour pas mal d’américains, les attentats du 11 septembre 2001 ont dû avoir l’effet d’un viol : un nouveau Pearl Harbor mais en pire, une brèche ouverte dans leur mémoire amnésique. Une béance dans leur inconscient collectif qui allait alors, comme cela avait déjà été le cas dans les années 1960-70 (pour d’autres raisons), et à l’image de ce fleuve aveuglant d’horreur sur lequel tombe Rachel en quête d’un petit coin, vomir tout un flot de refoulé charriant avec lui des cadavres : ceux d’une terre pas si vierge et pure que ça, ceux d’une histoire difficile à regarder en face et à laquelle certains « cinéastes-haruspices » allaient tenter de donner sens, ou du moins, comme ce semble être le cas ici, s’en servirent dans une entreprise de catharsis.
La « cité sur la colline » a pour fondations quelques très belles idées, et le travelling latéral, à la fin du film, depuis une statue victorieuse célébrant l’indépendance à un tripode hors-service encastré dans un immeuble montre que Spielberg, même en 2005, à son heure la plus pessimiste, croit encore en quelques unes de ces idées (Lincoln le confirmera sept ans plus tard). Mais la plus vielle démocratie du monde est aussi bâtie sur du sang (ça aussi, Lincoln en parlera). Et de ce sang, que les « martiens » pompent comme des boit-sans-soif et dont ils se servent comme « engrais » fertilisant la désolation qu’ils sèment sur leur passage, se nourrissent tous ceux qui veulent la voir s’effondrer.
Donnez à un joker de terroriste une cité fracturée. Ni une ni deux, vous le verrez travailler à élargir ses plaies, en faire sortir le pus, versant de l’essence dessus et mettant le feu au tout. KABOOM ! « Tadaaaaaaa ! Elle a dis-pa-rue. Plus de cité mais l’espace de nouveau vierge du chaos primordial : Ground Zero, ou le niveau auquel les twins towers, ces deux bras de l’Amérique tendus vers les cieux divins (de la finance mondiale) furent ramenés. Ground Zero, soit l’expression utilisée pour la première fois en juillet 1945 pour désigner le site où explosait la première bombe atomique de l’histoire. Ground Zero, une expression qui conviendrait aussi à Hiroshima et Nagasaki rasées par Little Boy et Fat Man, ou à Bagdad après le passage du Rolling Thunder américain en 2003, ou encore ici à cette East Cost étasunienne après la blitzkrieg des tripodes.
Ground zero, deux mots pour deux Amériques, deux faces d’une même pièce : l’une, la coupable (Robert Oppenheimer : « Now I am become Death, the destroyer of worlds »), refaisant surface dans le sang s’écoulant de la blessure de l’autre, la victime (George W. Bush : « Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorists acts »), Entre les deux : un lien, peu évident mais qu’a tout de même tissé un fou furieux d’ « oncle Ben », en justifiant la mort des civils présents dans les deux tours par celles des femmes et enfants pulvérisés à Hiroshima. Œil pour œil, sang pour sang !
Ces liens fous de la mort, ce sont ici les rayons avec lesquels un tripode godzillesque - qui pourrait être sorti de la béance sus-citée à la manière d’un kaiju de Pacific Rim ou d'un fleuve poubelle de l'Histoire comme le monstre dans le film-cousin The Host -, désintègrent ses victimes lors de la première attaque. Pulvérisant aveuglément hommes et femmes (et enfants ?) dans un terrible craquement ne laissant que poussière et morceaux de tissus flottants dans les airs, ces flèches électriques renvoient autant au feu nucléaire qu’aux imageries de la Shoah et du 11 septembre. Comment ? D’abord, en mêlant leurs cendres. Ces cendres, spores libérés d’une histoire trop lourde à porter et dont il faut se débarrasser dans l’évier. Ces cendres qui, une fois déposés sur le visage juvénile - parce que c’est Tom Cruise qui l’interprète - de l’infantile Ray, paraissent le faire vieillir de 20 ans en l’espace d’une ellipse. Ces cendres, enfin, qui lui font troquer sa fausse assurance échappée de Top Gun contre une démarche zombiesque, un regard hagard et une coupe poivre et sel à la Vincent dans Collatéral : soit trois caractéristiques d’un corps sur lequel on aurait projeté, comme sur un écran, la mort de masse.
Pour accompagner cette première litote, il y en a une autre : celle de ces vêtements voletant dans l’atmosphère du carnage en lieu et place de leurs propriétaires, disparus dans les plaies rouvertes de l’histoire. Ces vêtements que, plus tard, on retrouve, chutant comme la neige dans une forêt sombre (qui pourrait être polonaise, tchèque ou ukrainienne) et éclairée par les lumières glaciales de Janusz Kamiński (le fameux chef op’ que Spielberg a embarqué dans ses valises à partir de La Liste de Schindler).
Et que dire de la terrible musique industrieuse qui émane des machines - à croire qu’elles ont des fours crématoires dans leur ventre -, ou de ces images de campagnes dévastées au milieu desquelles errent des américains sans foyer : « fantômes de cimetières » à la Steinbeck , réfugiés de guerre jetés sur les routes comme autant de hobos et de okies ravivant les douloureux souvenirs de la Grande Dépression et de la reconstruction européenne d’après guerre. A la base, ces collines sont presque les mêmes que celles, lumineuses - parce qu’éclairées avec douceur par le grand Vilmos Zsigmond -, de Rencontre du Troisième Type. Mais entre temps, la campagne est devenue rouge de terre et de ciel, presque une exposition d’art contemporain ou l’œuvre d’un artiste surréaliste à la Dali (2), et les halos angéliques se sont mus en machines infernales (à plusieurs reprises, elles entrent dans le champ par en dessous). Cyclopes gloutons moissonnant les humains comme les fils de Poséidon le font avec les moutons peuplant leur île, ceux-là ne cherchent aucun élu, mais seulement leur jus : précieux nectar aspiré « à la paille » et que l’on devine aussi essentiel pour les envahisseurs des États-Unis ici que le pétrole pour ceux de l’Irak en 2003.
The We and the Aïe !
« Je n’essaye pas d’analyser ce qui se passe dans la tète des extraterrestres, mis à part qu’ils sont déterminés à tous nous éliminer. […] ils ont sûrement des plans pour notre planète mais on n’explore pas le côté : « Quelle est leur motivation ». On ressent juste les conséquences de leur plan infâme qui est de nous supplanter ». Comme Spielberg le raconte dans les suppléments du DVD, l’invasion extraterrestre n’est qu’un prétexte dans son film. Pour sa troisième « rencontre du troisième type », il n’a que faire des aliens en eux-mêmes. Ce qui compte pour lui dans le genre « film d’invasion extraterrestre », c’est le mot « invasion ». Ce qui l’intéresse, c’est l’effet qu’elle produit sur une population : le choc, l’effroi, la terreur. Et pour que cette terreur « beyond the imagination » soit la plus viscérale possible, il fallait que tout le reste soit rendu de la façon la plus « hyperrealist » possible, et que soient évités tous les lieux communs (réunions de généraux autour d’un plan du monde, destruction métonymique de lieux et monuments célèbres, notamment la pauvre New York, etc.). Raison pour laquelle le film, dés après le prologue qui paye son tribut à H.G. Wells, se démarque ensuite du roman et de la précédente adaptation hollywoodienne pour allait chausser le point de vue, non pas d’un scientifique, mais d’un col bleu (même si cela est atténué par le statut de star de Tom Cruise, c’est là un fait rarissime dans un blockbuster contemporain, mais La Guerre des Mondes n’est pas un blockbuster comme les autres).
Le dit col bleu, Ray, a, depuis sa grue, vue sur la nouvelle skyline décapitée de New York. Ce que montre cette première image, typique du "cinéma post-11 septembre", ce n’est pas un banal arrière plan, c’est l’absence, un vide, une empreinte fantôme que tout le reste du métrage porte dans son ADN, et tâche d’exorciser en collant toujours à cette vérité du « John Doe » américain sorti des gravats du World Trade Center (de son nom latin homo americanus postonzeseptembrus). Spielberg prend ainsi le temps de planter le cadre - criant de vérité parce que tourné sur site - de cette petite ville du New Jersey filmée à hauteur d’homme pour ensuite la plonger dans une horreur qu’il n’avait jamais poussée aussi loin, si ce n’est dans La Liste de Schindler (« C’est la première fois que j’ai plongé les yeux grands ouverts au beau milieu d’un film d’horreur et de science fiction »). Et peut-être est-ce en partie de ce dernier qu’elle vient, cette horreur. Comme si la complète bascule du cinéaste, au début des années 2000, dans son versant le plus sombre - versant présent dés l’origine mais jamais aussi explicite avant A.I. - venait aussi d’un besoin d’expulser ce trop plein de savoir. Un savoir toxique pour la santé mentale et qui se serait accumulée en lui lors de la production, forcément très éprouvante, de son film sur l’Holocauste pour finalement trouver, ici, une forme cinématographique hantée en lieu et place de la reconstitution.
Ces extraterrestres sont donc moins des réalités tangibles que des réceptacles aux peurs d’un homme et son époque. Les idées qu’ils génèrent priment sur leur réalité concrète. De façon symptomatique, le corps de l’Autre est presque toujours remplacé par son double métallique de 45 mètres de haut, et ces fameux tripodes, figures iconiques au possible, sont aussi des figures quasi abstraites (comme leur cousins bobysnatchers qui eux aussi sortaient de cellules placées en sous-sol). Masses technologiques et concentrés d’horreurs historiques, ils tendent un miroir à la face du monde occidental à l’heure où celui-ci voit émerger sur la scène médiatique une nouvelle espèce de monstres, qu’il a contribué à créer. Dans ce cadre, l’effet que propagent les engins, en « sonnant du cor », devient celui du terrorisme sur une société : sa fracturation (les fissures qui déchirent le sol alors qu’émerge la première machine), la brisure des liens qui font sa cohésion et sa conversion en autre chose, quelque chose de monstrueux.
« Un des animaux les plus laids (ugly) est l’esprit d’une foule [,] une foule [qui] agit comme un organisme unique avec, comme seul but, de survivre, détruisant tout ce qui est sur son chemin pour arriver à ses fins ». Ces paroles du réalisateur, ce pourrait être celles d’un exégète du cinéma de John Carpenter. Et de fait, on peut penser à celui-ci lorsque la camionnette dans laquelle fuient Ray, Rachel et Robbie arrive dans une ville lugubre où ont échoué un grand nombre de réfugiés. C’est une scène carpenterienne typique à laquelle on assiste alors : les trois personnages se retrouvent coincés dans un espace claustrophobique, la camionnette, prise d’assaut par une masse désordonnée de bras qui, tous, cherchent à rentrer dans l’habitacle, à agripper ses passagers. Une fois éjecté de ce « territoire », ces derniers se retrouvent pris dans une bagarre chaotique, et c’est à celui qui restera le plus longtemps possible dans le champ : autre territoire d’où sont bientôt (et encore une fois) éjectés Robbie, d’abord, puis Ray, ensuite, laissant Rachel livrée à la furie de la foule.
Autant dire qu’à ce moment, il n’y a plus de peuple qui tiennent. A celui-ci s’est substituée une « mob » sans tète (parce qu’elle l’a perdue), une « crowd » grouillante d’individus à peine individualisés et se battant pour le moindre centimètre à l’intérieur du cadre (comme plus tard pour une place dans un ferry à la Titanic). C’est un phénomène proprement terrifiant que filme là Spielberg (bien plus que les aliens eux-mêmes). Et à cette contamination par la peur répond l’ultime réflexe américain, celui du recours à l’arme : une balle comme pour achever le corps moribond d’un peuple désormais désintégré, une balle pour enfoncer le dernier clou dans son cercueil (la NRA aura sans doute apprécié).
A l’opposé de cette scène, il y a celle où, retenu prisonniers dans la « bétaillère » d’un tripode, les humains font cette fois corps ensemble pour retenir Ray aspiré vers une mort certaine. Ou un peu plus tôt : celle où un couple, retenu par l’instinct maternel de la femme, s’arrête devant Rachel, seule - au moment où Ray court après son fils parti « combattre » -, et cherche à la secourir contre sa volonté. Il y a comme ça dans le film quelques moments où les idées de peuple et d’humanité sont momentanément déterrées par quelques éclairs de solidarité passagère ; si bien que l’humeur générale du film paraît bipolaire : prise dans un continuel va-et-vient entre pulsions de délitement et tentatives de raccommodage. Mais quand on est attaqué sur tous les fronts, le délitement devient séisme, et Ray, qui n’est pas Ethan Hunt, ne peut courir partout, pas plus qu’il ne peut retenir à la fois son fils et sa fille, tous deux emportés par des courants opposés. Parce que Ray, qui n’est pas d’avantage Lincoln, n’est pas armé pour maintenir la cohésion d’une famille dont il n’a jamais fait partie. Et à travers cette faillite - grand sujet du cinéaste -, c’est à la dislocation de la nation américaine sous les coups de boutoir de la peur qu’on assiste. La peur comme « arme de fracturation massive », ou quand son propre voisin devient un Autre à ses yeux.
Et des yeux, de ce qu’ils voient et ce qu’on leur cache, il en est beaucoup question dans La Guerre des mondes.
There’s no place like home
Hallucinant, le voyage de Ray, Rachel et Robbie à travers les décombres d’une Amérique livrée à l’extermination de masse l’est assurément. Au milieu de ce maelström catastrophique, surgissent même par moment des flashs multicolores : palpitations totalement irréelles (bleu, violet, blanc, vert), crépitements agressifs, presque psychédéliques, ou l’impression de voir là, transposée quelque part en Nouvelle Angleterre, une version sous acide, comme shootée par un journaliste gonzo, du champ de bataille européen au plus fort de la Seconde Guerre mondiale. Parce que c’est aussi ça La Guerre des Mondes : le spectacle, dans sa version la plus viscéralement hantée par la vérité historique, de l’Apocalypse dans toute sa terreur et aussi toute sa splendeur (malheureuse splendeur). Impossible, en effet, de décrocher son regard de ces images (un réacteur de 747 planté au milieu d’un salon, le passage d’un train en flamme, une nuée d’oiseaux volants vers la silhouette d’un tripode au sommet d’une colline, etc.), toutes aussi fascinantes et, en même temps cauchemardesques, qu’un champignon nucléaire en train de se former, ou qu’une lumière aveuglante que, dans un chef d’œuvre de 1987, un enfant devenu sauvage prenait pour l’âme d’une figure maternelle montant au ciel alors qu’il s’agissait de l’explosion de Little Boy.
Comme chez nombre de cinéastes (et peut-être plus encore), la question du regard est cruciale dans l’œuvre spielbergienne. Et le réalisateur ne manque jamais de le rappeler : ici, un écran de caméscope, là, un reflet dans un rétroviseur, ailleurs, la forme d’une sonde extraterrestre. Écrans, vitres, miroirs, étendues d’eau, yeux humains, mécaniques ou extraterrestres : les surfaces réflexives sont presque de tous les photogrammes. Et c’est de voir tout en étant soi-même jamais vu que dépend la survie des personnages. Un petit jeu auquel ils se prêtent exemplairement dans la double-scène - reprenant celle, fameuse, des cuisines de Jurassic Park - où les envahisseurs visitent leur cave. Et là encore, la parade tient en un effet de miroir, un trompe l’œil. Car l’œil, chez Spielberg, est une surface particulièrement sensible, vecteur d’émerveillement (soit la scène spielbergienne typique, ici : un orage vers lequel convergent les vents) mais aussi de danger (les faisceaux lumineux des tripodes dans lesquels il ne faut surtout pas être pris) et surtout, de plus en plus, de traumas (le spectacle d’une ponction sanguine sauvage). Combien, justement, de regards traumatisés dans ce film, que ce soit celui de Ray après avoir assisté, croit-il, à la mort de Robbie, celui d’Ogilvy après avoir compris qu’est-ce que c’est que ce liquide rouge, ou celui de Rachel lorsque sont père la retrouve dans la « bétaillère » d’un tripode ?
Est-il possible de garder ses yeux vierges de toutes les horreurs du monde ? Peut-on conserver l’innocence de « nos chères tètes blondes » à l’heure où les flux multimédias charrient toujours plus d’atrocités ? A ces questions que posent son film, Spielberg répond en se faisant aussi peu d’illusions que les frères Nolan à propos de la pureté de la démocratie américaine dans The Dark Knight. On peut serrer les fesses, se boucher les oreilles, se bander les yeux, et se chanter une berceuse comme pour s’auto-persuader que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais c’est un vœu pieu. Le monde déborde d’horreur, cette horreur a fait une percée dans le territoire mental US, et tous les canaux de perceptions de la fillette ne peuvent être barricadés. Celui qui se voile la face à ce moment, c’est Ray. Même s’il prend soin de fermer la porte sur ce qu’il a à faire - irreprésentable dans un film hollywoodien classé PG-13 -, ce n’est pas un secret pour Rachel : le hors-champ est, en quelque sorte, plus puissant, trop puissant. Pour preuve, elle va réconforter son père une fois la chose faite.
Et si l’on peut parler de Ray en tant que père à partir de là, c’est parce que c’est dans cette scène qu’il le devient vraiment, par un geste aussi paternel (protéger sa fille) que criminel (tuer un homme victime de sa folie). Un acte qui vient ainsi entrelacer le meilleur et le pire de l’humanité au cœur du lien filial en train de naître et qui, déjà, contient en germe sa future destruction : la mort, qui tel un orcruxe d’Harry Potter, s’accroche en hors-champ à la vie.
Alors le cinéaste peut bien reprendre le final de La Prisonnière du désert (explicitement cité dans le plan où la mère, en mode Pénélope fordienne prise dans un sur-cadrage tout aussi fordien à l’entrée de la maison, voit le retour de sa fille au foyer) parce que l’amertume qui se dégage de cette « happy-end » est la même que celle du film de John Ford. Robbie a miraculeusement survécu et appelle Ray « Papa », mais il est filmé comme une ombre (à peine voit-on son visage). À croire que Spielberg lui-même n’y croit pas - en tout cas, moi j’ai du mal -, et qu’il filme contre le scénario en n’investissant pas plus les retrouvailles père-fils (encore une fois la tension délitement/raccommodage qui penche du premier côté). Ray a ramené la gamine, mais celle-ci, comme Debbie, la fillette kidnappée du film de Ford, et comme le petit Jim à la fin d’Empire du soleil, a perdu son innocence. Et lui, Ray, le sauveur, se voit maintenu à distance, ostracisé, comme arrêté par un droit de cité qu’il aurait perdu en tuant pour survivre (le genre de réflexe animal que ne veux surtout pas voir le puritanisme).
Dans Road Movie, USA, Jean Baptiste Thoret et Bernard Benoliel écrivent que, dans le cinéma américain, « on ne devient pas héros contre le peuple, et l’individu n’est fort qu’à condition de savoir englober le collectif, de lui servir de courroie de transmission ». A la fin de La Guerre des Mondes, il n’y a quasiment plus de peuple, et Ray n’est pas un héros, du moins pas celui que l’Amérique voudrait. Comme Ethan Edwards et the dark knight, Ray Ferrier porte l’opprobre parce qu’il a plongé les mains dans le sang pour maintenir l’illusion d’une famille (et d’une nation) américaine unie. Mais ça ne fait justement plus illusion pour personne : la courroie a lâché (3).
Autre lecture (plus personnelle) : Spielberg est un « gosse de divorcés », et l’influence de cette « brisure » de son enfance sur son œuvre est sur-connue (cf. la terrible scène d’Arrête-moi si tu peux où Frank Abagnale Jr., tel Charlot devant la fenêtre du saloon de La Ruée vers l’or, voit sa famille devenue celle d’un autre enfant). L’on peut même penser que cette tension délitement/raccommodage, qui varie dans un sens ou dans l’autre suivant ses films, vient de son rapport à ce père qui, une nuit, le réveillait pour allait observer le passage d’une comète et, un autre jour, l’ « abandonnait ». Ici, la vérité (à peine hypertrophiée) du père divorcé est partout (le V8 sur la table de la cuisine, le frigo rempli de tout sauf de nourriture comestible, les blagues téléphonées que déteste le fils, etc.) et en particulier dans la scène finale. Celle du père divorcé qui, après avoir traversé toutes les épreuves, une véritable odyssée, un week-end d’enfer (au sens propre), « largue le colis » sur le pallier de la maison dont il est banni à perpétuité. Il se retrouve alors là, comme un « pauv’ con », maintenu à distance par le regard de beaux-parents veillant à lui rappeler sa place (ex-mari « raté », père « incompétent » et blue collar contre famille unie, « aimante » et bourgeoise), et contraint de retourner d’où il vient. Sauf qu’il n’y a plus rien là-bas, mis à part le vide laissé par la perte (de la femme, des enfants, du foyer).
Et Spielberg de contredire là le principal lieu commun des films-catastrophes hollywoodiens : celui voulant que, dans l’adversité, face au tremblement de terre, aux soucoupes-volantes martiennes - ou soviétiques, on ne sait plus trop -, à l’astéroïde qui s’apprête à se crasher sur Terre, au brusque refroidissement climatique, etc., les liens de la famille et de la patrie se resserrent pour célébrer, de la façon la plus artificielle qui soit, la fiction de l’infaillibilité d’une nation américaine qui construirait sa cohésion sur le ciment de l’ennemi commun.
Mais alors, qu’est-ce qui reste ? Les idées : une croyance mêlée d’érudition historienne contestable en l’échec de toutes les invasions : française de l’Agérie, « martienne » de la Terre, « échardienne » de l’épiderme ? Les symboles : un monument qui a résisté à l’envahisseur, un fils devenu homme se réconciliant avec son père, un bourgeon vert au bout d’une branche morte ? Les grandes phrases : « les hommes ne vivent ni ne meurent en vain » ? Ou peut-être cette certitude - raccord avec la morale de Jurassic Park - qu’il y a quelque chose d’infiniment plus grand, même si, parfois, cela prend une forme de l’ordre de l’infiniment petit, quelque chose que le narrateur appelle « Dieu » mais que l’on préférera, en bon mécréant (et fier de l’être !), appeler nature : cette tueuse professionnelle qui, en usant des microbes pour sauver la mise à l’humanité (et particulièrement à l’Amérique) lui donne une bonne leçon d’humilité ?
En tous les cas, une chose est certaine (à mon sens) : jamais depuis 1991 avait-on vu dans un produit hollywoodien d’images d’Apocalypse aussi traumatisantes. Et les masses de spectateurs aguichées à l’idée de voir un nouvel Independance Day en mieux (parce que réalisé par le maître et non par un "padawan" l’imitant), auront été plus que décontenancées à la vue de ce flux d’images. Car il ne s’agissait pas alors de donner son quota de destruction massive annuelle et sans conséquences au spectateur pour qu’il en jouisse confortablement installé dans son fauteuil avec sa poubelle de pop corn sur les genoux, mais bien de prélever l’inquiétude du monde à un moment donné et de la métaboliser sous la forme d’une œuvre malade et géniale où Spielberg régurgitait ses traumas et ceux du XXe siècle avec une poésie horrifique digne de figurer dans un musée. L’auteur montrait ainsi, une nouvelle fois après A.I. et Minority Report que c’était au fond du trou, dans le creux dépressif de son humeur la plus noire - peut-être le moment le plus passionnant de la carrière du Monsieur -, qu’il cuisinait désormais son cinéma. Et pour un film encore, Munich, il allait remettre ça, signant ainsi un diptyque de la terreur pouvant correspondre, il me semble, à ce que Frédéric Bas appelle des « films malades de l’histoire ».
(1) « La préservation d’une forme d’invulnérabilité face aux menaces extérieures est une donnée fondamentale de la culture stratégique américaine. Le développement et la mise en place de dispositifs militaires destinés à préserver cette invulnérabilité […] relèvent d’une logique spécifiquement américaine qui se distingue de nombreux États qui ont intégré la vulnérabilité comme un élément fondamental de leur posture stratégique. L’existence de deux océans et la présence de deux États […] n’offrant aucune menace pour la sécurité américaine, avaient développé un sentiment de sécurité et d’invulnérabilité. Le lancement de Spoutnik en 1957 et le développement des missiles avaient rendu le territoire américain vulnérable. Tolérée dans une certaine mesure dans le cadre de « l’équilibre de la terreur », cette vulnérabilité est redevenue moins acceptable pour une large partie de l’opinion publique américaine avec la prolifération des armes de destruction massives et des missiles. D’où la popularité des systèmes de défense anti-missiles, de l’Initiative de Défense Stratégique du président Reagan à la Missile Defense du président George W. Bush. Paradoxalement, le souhait des Américains d’assurer « l’invulnérabilité » de leur territoire pourrait être renforcé au lendemain des attentats du 11 septembre. » (Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Yves-Henri Nouailhat).
(2) Cf. ses éléphants aux fines et longues jambes sur fond rouge.
(3) Et il serait intéressant de se demander pourquoi ces deux films (La Guerre des Mondes et The Dark Knight), parmi les plus importants du « cinéma post-11 septembre », citent ainsi les finals des deux grands classiques de John Ford : La Prisonnière du désert pour le premier et L’Homme qui tua Liberty Valance pour le second, deux films mettant en scène la fin de la mythologie américaine et ses héros à l’aube d’une époque de crise pour le pays.