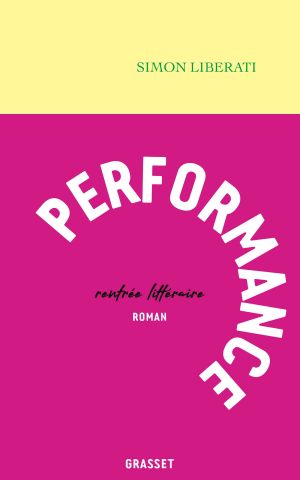Chronique vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WekVRvP2Wh4
De quoi ça parle ? On y suit le narrateur, âgé de 71 ans, écrivain qui n’écrit plus, et qui va cachetonner pour une série Netflix sur les Rolling Stones dans les années 70. A côté, on suit son quotidien, avec Esther, sa nouvelle compagne, fille de son ancienne femme, âgée de 23 ans.
C’est difficile pour moi de juger ce livre, juger une œuvre devrait s’affranchir de la morale. Donc je vais essayer d’évoquer ce qui m’a dérangé de la manière la plus prudente possible. Parce que même si on a pas envie de faire notre Sainte-Beuve et de juger l’homme, quand il s’agit d’un texte autofictionnel, ça s’avère plus compliqué, car l’homme c’est le sujet, c’est la matière du texte.
Je vais commencer par parler de ce que j’ai apprécié dans ce texte, puis on va expliquer en quoi la polémique qui va suivre ou non la médiatisation de ce texte est selon moi assez justifiée.
J’ai aimé la précision de Liberati, le fait qu’un des procédés qu’il affectionne soit l’hypotypose, qu’il utilise beaucoup dans les passages sur les Rolling Stones pour les faire revivre comme à l’époque : l’énumération de détails suit une progression visuelle, comme si on assistait à ces scènes, comme une caméra qui zoome de plus en plus pourrait dire les deux producteurs de la série sur laquelle il travaille. Par contre, il a tendance à faire des généralités, des sentences qui sonnent littéraires mais qui auraient gagnée à être de temps en temps remise en question, on ne comptera pas par exemple le nombre de fois où apparait le groupe indéterminé des « femmes ». La littérature c’est sans doute l’observation, noter que tel groupe de personnes agit de telle manière, les agents immobiliers, les policier, etc,. (c’est bien pour le tableau d’ensemble que l’on fait). En revanche, il faut aussi contrebalancer avec la distinction, surtout quand on rentre dans le détail (ici avec Esther par exemple. Or, il ne le fait jamais, elle ne contredit jamais ses idées généralistes sur les femmes. La palme revenant à « Intuitive comme toutes les hystériques, même si cette hystérie chez elle était rentrée » Même quand ça ne correspond pas à son idée de base, il fait une pirouette pour faire rentrer Esther dedans, et on ne commentera pas le terme d’hystérique, à minima malvenu).
Ce que j’ai trouvé assez amusant, c’est la manière dont Liberati peint notre époque, ridiculisée sous les traits des deux producteurs de cette série Netflix sur les Rolling Stones (ces deux producteurs qui m’ont fait penser aux pubeux du film The Square — toujours penser à l’audience, à la réaction de leur public-cible), donc une époque bégnine qui joue sur une nostalgie totalement faussée qui prend plus en compte l’optimisation et la budgétisation du projet que son esthétique.
Tous ces passages sont assez marrants, entre lui qui est là pour remplir les caisses et leur servir un peu de sa féérie d’it-boy vieillissant, qui perd par conséquent de sa féerie pour devenir une soupe à la recette facile, et eux dont les remarques visent toujours à côté. On ajoute la figure du réalisateur coréen étonnamment profond et mystique, et malheureusement, du name dropping à gogo (d’ailleurs le name dropping serait presque un procédé littéraire avec Liberati — quand il parle littérature, quand il parle musique, il aime balancer des noms en veux-tu en voilà, mais ça a malheureusement un côté artificiel voire cuistre puisqu’il ne prend pas le temps d’expliciter un peu ses références. Alors certes, je dis souvent que je veux de la précision en littérature, mais je pense que plus obscure est la référence plus il est nécessaire de l’expliquer : le but de la littérature n’est pas de faire le malin, si tu veux utiliser des notions oubliées, c’est bien de les mettre en scène, pas juste les balancer pour montrer ta culture. J’ai trouvé que ça donnait des airs compassés au texte, que ça pouvait retirer de la spontanéité à certains moments, que les moments où c’est pertinent, c’est surtout les passages où ils parlent de ces années 67-70. Car c’est toute une reconstruction historique qui doit être faite, sans paraitre en être une, et que donc virevolter d’un nom à l’autre comme si on les connaissait tous, ça donne un côté réaliste au texte. J’aurais cependant apprécié plus de passages, qu’il tire plus sur les fils, parce qu’on a souvent la désagréable impression qu’il rompt la rêverie, même si je peux aussi comprendre que c’est son intention.
On aime bien les quelques extraits où il se représente comme une des dernières figures d’une aristocratie agonisante, un homme de lettres et de culture comme l’entendraient plutôt les siècles passés, et le ridicule du hiatus qu’il y a entre le fantasme de l’écrivain et la réalité égaye parfois le texte — sa demeure est en ruine, il se claquemure avec sa nouvelle compagne pour éviter le scandale, s’habille de vêtements mités « L’écrin avait beau être vide, l’écrivain disparu, l’individu qui jouait son avatar avait encore la tête de l’emploi avec sa robe de chambre Old England en tartan vert et bleu, son pyjama Charvet et ses pantoufles de velours. Je recouvris la robe de chambre par une sorte de super-robe de chambre, un manteau Lanvin croisé en cachemire marron d’Inde troué aux mites […] ». Mais bizarrement on a aussi l’intuition qu’il aime cette image, que le ridicule est une sorte de transmutation qui se produit dans l’œil du lecteur sans que ce soit souhaité par l’auteur — il cite ces marques et la recherche encore étudiée de ses tenues comme un dandy qui a malgré tout encore du goût, une sorte de manière de perpétuer sa distinction de classe, de montrer que malgré la ruine, il restera ce noble au-dessus de la masse, cet aristocrate au goût sûr. Ce fossé avec le lecteur lambda, il dérange à deux ou trois reprises :
On sent que Liberati cherche, comme il l’a dit dans un de ses précédents roman Eva, à « ne séduire que l’élite ». Dès le début, le geste hiératique d’ouvrir la fenêtre dès que le petit personnel se barre est éloquent — ici, le petit personnel, c’est les dealeurs, qui sont les seuls personnages qui ne viennent pas de la bourgeoisie ou de la petite noblesse comme dit Liberati. Le petit peuple ça pue, semble -t-il écrire. Ou encore quand la décoratrice médit du réalisateur « Ségolène se régalait des déboires du réalisateur et de ses assistants. Cette malveillance de domestique m’agaçait ». Et enfin, quand Esther ose le contredire, cela fait ressortir son milieu d’origine au yeux du narrateur, ce qui lui fait dire « Comment cette oie osait-elle me faire les gros yeux, me reprocher à moi, de cette petite voix agacée où une pointe de vulgarité laissait voir un peu d’accent vaudois, comme ces anciennes prostituées rangées dans un intérieur bourgeois qui laissent couler un mot ordurier trahissant ce qu’elles cherchent à cacher » — Il essaie lui-même de cacher derrière une peinture de mœurs très 19ème son mépris de classe, son mépris du féminin aussi, où dès qu’Esther s’éloigne de la petite fille qu’il esquisse, la sentence est redoutable, elle devient une poissonnière.
Et parallèlement à cette intrigue sur la série et sur l’écriture, il y a aussi la relation qu’il entretient avec Esther, une jeune femme de 50 ans sa cadette, fille de son ex-femme, particulièrement malaisante.
Parce que ce qui dérange, c’est pas tant la différence d’âge que le rôle de femme-enfant dans lequel il l’enferme. Ce qui donne en plus un aspect assez répétitif au roman (et qui me fait d’ailleurs me demander s’il a été suffisamment relu par son éditeur, on note par ailleurs la mention à deux reprises du portail cadenassé de leur maison). Pour vous montrer ce que j’entends par là, je vais vous mettre maintenant toutes les citations qui mentionnent la jeunesse ou la fraicheur d’Esther :
« L’amour des très jeunes filles est d’une eau plus transparente que les sentiments même ardents d’une femme plus âgée »
« De toutes les femmes que j’avais aimées, Esther était sans doute l’une des trois plus belles, et la plus jeune ».
« Enfantine, elle aimait que je lui relise sans cesse les mêmes choses »
« Jamais plus elle ne serait aussi séduisante qu’en ce moment et elle offrait ses lys et ses roses à un vieux desperado désargenté, édenté et parfois saoul. »
« Certaines filles très belles et très jeunes se montrent extrêmement sensibles à la beauté au sens large »
« Esther avait un con si frais que j’aurais pu lui arracher la langue ou les oreilles d’un coup de dent »
« Esther n’avait pas envie d’être mère, elle m’avait dit « on ne fait pas un enfant à un enfant »
« je ne voulais pas que la petite finisse sur le trottoir, un de ses fantasmes récurrents »
« Et puis elle rit de ce rire dont la jeunesse est prodigue et qui disparait vers 30 ans. »
« C’était une enfant, mon enfant, je ne pouvais pas supporter de la faire souffrir ».
« Je restai impassible, ses colères d’enfant ne m’impressionnaient pas »
« Peut-être parce qu’elle n’était pas une femme, parce qu’elle était demeurée dans cette région de l’enfance où certaines petites filles ont la droiture simple des garçons ».
« Dans les tortures permanentes que m’infligeait la vie aux côtés de cette enfant »
« Je pensai à la jeune fille qui dormait près de moi comme l’ogre pense à la chair fraîche. Je n’étais pas excité physiquement, mon sexe petite chose sentant l’urine n’avait rien à voir avec le cep de vigne noueux, long et dur comme un manche de tire-bouchon que j’avais introduit tout à l’heure dans la vulve fraiche de la jeune fille »
« Le plus terrible, dans les amours entre un vieil homme et une jeune fille, ce n’est pas le vieillissement de l’homme, ce singe rusé menaçant ruine depuis des décennies, mais le flétrissement de la jeune fille ».
On a l’impression que c’est uniquement la jeunesse qui l’intéresse, que c’est uniquement par ce prisme qu’il la perçoit, ce qui donne un côté vampirique à son personnage — Esther n’est qu’une sorte de memento mori, un calice dans lequel il s’abreuve désespérément. Il faut préciser en plus, ce qu’on voit dans certaines citation « torture permanente », qu’il se plaint de la situation et retourne la culpabilité sur la séduction d’Esther, comme un Humbert Humbert qui ne prend même pas la peine d’être cynique (il faut savoir que toute la partie sur Esther est autobiographique, excepté qu’elle n’est pas directement la fille d’Eva Ionesco, mais sa belle-fille. De plus, elle souffre d’anorexie, de toxicomanie, et dépendante financièrement de lui semble-t-il, comme il dit « Je la tenais par un lien souple mais solide ».)
Ça joue toujours sur la même note, et en plus d’avoir un côté crypto/pédophile, de jouer même sur la corde de la culture de l’inceste (concept qui reprend la formule culture du viol pour montrer comment l’art ou la société peuvent parfois légitimer l’inceste), ben le roman va toujours dans ce sens, ce qui donne un aspect unidimensionnel à leur relation. En fait, ce que j’aurais voulu, c’est pouvoir être touchée par cette relation, ou alors au contraire pouvoir en rire — quand Houellebecq est limite sur ses plans là, c’est assez dégueulasse, y a assez de distance pour me faire marrer. Liberati se prend trop au sérieux, trop au premier degré, y a même à une ou deux reprises des remarques assez pénibles dans la manière dont il se peint.
« On ne me donnait pas toujours mes 71 ans, le visage régulier entre les poils, la stature martiale et une bonhomie pleine de simplicité mêlée au reste d’une éducation à l’ancienne, sans compter mes grands pieds et mes mains puissantes prometteuses de certaines voluptés[…] »
Quand on écoute ce qu’en dit le masque et la plume, on voit que c’est l’éléphant dans la pièce, je suis sûre que tous, et surtout les femmes, ont mis le doigt sur l’aspect pédophile de ce texte, mais relativise. Ce qui est ironique, c’est que Liberati dit ce lieu commun : « La société parisienne, naguère si libérale de mœurs, était devenue moralisatrice et jalouse », le masque les contredit d’une part, et me fait m’interroger, sont-ils complaisants pour ne pas paraitre moralisateurs et jaloux, a-t-elle déjà été moralisatrice et jaloause, cette société parisienne — on pense à Matzneff, on pense à la libération de la parole, au monde d’après et toute les conneries qu’on entend à la radio et à la télé. Si ce roman permet de démontrer cette hypocrisie, qu’il n’y a jamais eu d’ère post Metoo, à part un argument marketing de magazines féminins, que c’est aussi un enrobage que sortent les dominants pour se justifier, parce qu’il se sont fait prendre la main dans le sac, à soutenir des hommes tels que PPDA, Matzneff, et cie. Beigbeder a fait son mea culpa pour ce dernier, on voit que se désolidariser de Matzneff, c’était surtout pour ne pas être éclaboussé par lui. Rien n’a changé, on est en 2022, et un livre qui parle de vulve fraiche de jeunes filles vient de gagner le Renaudot.