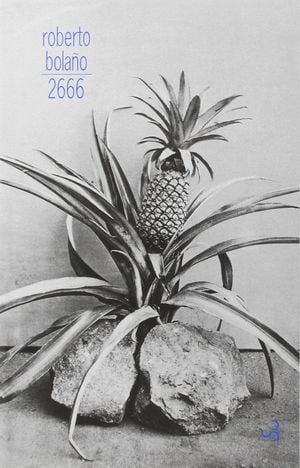R. Bolaño, en un sens, avait déjà prévu et réglé mon cas : « Il choisissait […] Un cœur simple plutôt que Bouvard et Pécuchet […]. Même les pharmaciens cultivés ne se risquent plus aux grandes œuvres, imparfaites, torrentielles, celles qui ouvrent des chemins dans l’inconnu. Ils choisissent les exercices parfaits des grands maîtres. Ou ce qui revient au même : ils veulent voir les grands maîtres dans des séances d’escrime d’entraînement, mais ne veulent rien savoir des vrais combats […] ». Et on ne pourra pas nier qu'il y ait dans ma préférence pour Un cœur simple toutes les germes de mon sentiment partagé sur 2666. Cette prévision désarmante justifierait à elle seule que l'on porte de l’attention à 2666 — roman que je n'ai pas vraiment aimé, mais que je me sens (que l'on se sent) obligé de justifier n'avoir pas aimé.
Pour tenter de dire quelque chose de 2666, commençons par un inventaire du matériel : le roman est composé de cinq parties, de longueur assez inégale. La première rapporte la vie d’un groupe de critiques multinational qui étudient l’œuvre de Benno von Archimboldi, un écrivain allemand qu’ils contribuent à faire éclore à la postérité, et qui échouent à Santa Teresa (Mexique) en le recherchant) ; la seconde parle d’un professeur de philosophie lunatique qui vit aussi à Santa Teresa ; le troisième d’un journaliste non-sportif, dans le même lieu ; la quatrième égrène les meurtres de femmes à Santa Teresa (sur le modèle de ceux de Ciudad Juarez) et leurs vagues tentatives d’élucidation ; le cinquième, enfin, nous fait découvrir Benno von Archimboldi. Cette organisation laisse imaginer au lecteur quel pourrait en être le barycentre (Santa Teresa ? la mort ? le mal ? la littérature ?), même si l’on pressent aussi que le roman n’a pas de “propos” d’ensemble comme peuvent en avoir d’autres pachydermes littéraires, même s’il a indéniablement un “projet”.
C’est par ce projet que 2666 m’a paru avoir pêché.
R. B. décrit certes admirablement le petit monde de ses critiques dans la première partie, et atteint quelques moments de vérité littéraire (lorsque Pelletier et Espinoza, pensant à Liz Norton, se rendent compte simultanément qu’ils ne pourront pas vivre pour le plaisir de se disputer avec des critiques allemands sur les lectures croisées de Günther Anders et von Archimboldi ; ou par le parallèle entre Morini et Schwob) et quelques moments de vérité plus ordinaires, dits sur leur ton du bon mot, mais encore réjouissants (sur le ridicule et la pompe des congrès, des mystérieuses cabales ourdies entre deux groupes d’archimboldistes ; sur la l’auteur fictif de La Rose illimitée ou de Bifurcaria bifurcata, qui mérite une place au Panthéon littéraire aux côtés de Marc Ronceraille et Bergotte). On en trouverait aussi dans la deuxième partie, sur Amalfitano, étrangement juste (peut-être parce qu’Amalfitano contient plus d’un rappel biographique de Bolaño) et parfois très poétique (ainsi, lorsqu’elle évoque le ready made “malheureux” de M. Duchamp), mais aussi dans la cinquième et dernière partie. Cela m'a rappelé, très étrangement, Les Anneaux de Saturne de W. Sebald (comparaison que je m'efforçais de refouler lorsque je me suis rendu compte qu'une critique littéraire avait eu exactement la même idée).
À cette justesse du « périphérique », de l’ordinaire répond toutefois une difficulté d’atteindre ce que l’auteur paraît se donner à lui-même comme but, lorsqu’il traite de ses sujets les plus intenses.
Le sexe : on s’étonne du tour stylistique répété des relations sexuelles “horloge parlante”. Les personnages « baisent » une, deux, six heures, jusqu’à cinq heures du matin, sans autre forme de procès, au cours desquelles les femmes jouissent une, deux, trois fois… comme une façon d’évacuer par la répétition procédurale l’un des nœuds secrets, si l’on ose dire, de la vie et de la littérature.
La violence : on retrouve le même tic, de manière plus visible encore, dans la litanie des morts de Santa Teresa. Ici, cette répétition est évidemment voulue et qu’elle n’est pas sans mérite stylistique ; le lecteur, même dubitatif, ne peut s’empêcher d’être irrésistiblement attiré par ce « trou noir » (l’expression revient beaucoup ; déjà dans la recension du TLS en 2005, Amaia Gabantxo écrit que « tous les personnages principaux de 2666 sont comme une galaxie entourant le trou noir créé par les meurtres de Santa Teresa ; tous s’approchent de ce vide tout en luttant contre lui ») ; mais il ne peut pas non plus s’empêcher de se demander si le sujet extraordinaire qui a été choisi, celui des disparues de Ciudad Juarez, ne fait pas l’essentiel de la force du récit.
Pour le dire autrement, je ne suis pas certain que le genre du roman exprime ici sa qualité essentielle, celle d’être en quelque sorte “médiumnique”, de saisir ou de précipiter des vérités diffuses non par l’explication, mais par le récit, qui se transforme en une méthode divinatoire. De manière un peu incidente, l’esthétique de R. Bolaño m’a fait penser à une remarque d’A. Huxley sur Chaucer : « les collines, les fleurs, la mer et les nuages ne sont pas, pour lui, des transparences au travers desquelles les mécanismes d’une grande âme sont visibles. Non, ils sont opaques […] ». De la même façon, alors que R. Bolaño s’approche de ses grands sujets, les objets qu’il anime deviennent étrangement opaques, ce qui pourrait être une leçon en soi, mais sans que cette opacité ne nous dise quelque chose sur elles (à comparer avec le genre du roman noir, où l’absence de l’intériorité livre au contraire une sorte de vérité brute).
Voilà en somme l’impression d’ensemble qui m’empêche de voir dans 2666 un grand roman, même s’il s’agit certainement d’un roman méritoire (et sur lequel il y aurait beaucoup d'autres choses à dire) : ce qui se donne pour l'essentiel et le plus haut est une impasse, distrayant du plus humble et de l'ordinaire, où perce souvent quelque chose de vrai.