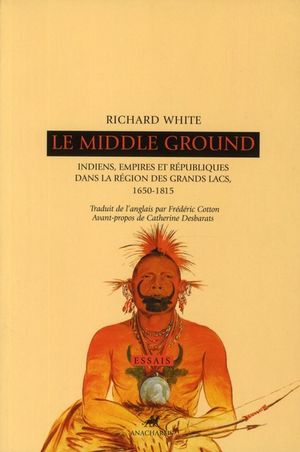The Middle Ground est un grand livre d’histoire qui porte sur une cheville méconnue de l’histoire mondiale : cette longue période durant laquelle les Européens du Nouveau Monde ont voisiné des sociétés autochtones encore très présentes et, dans certains cas, dominantes. Cette longue coexistence est parfois masquée par le récit de l’effondrement des sociétés américaines sous l’effet des maladies et de la guerre (voir, à ce sujet, le 1491 de Ch. Mann), bien que de nombreux historiens aient justement souligné qu'il était injuste de sous-estimer les longues interactions entre colons et amérindiens (cf., p. ex., Matthew Restall qui rappelle que la dernière cité Maya indépendante, Nojpetén/Tayasal n'est pas conquise par les Espagnols avant 1697, presque deux siècles après les premières expéditions dans le Yucatan).
Sans s'arrêter au constat, R. White dresse un portrait complexe des interactions entre les sociétés, autour de son concept central du middle ground — expression difficile à traduire car elle désigne à la fois un “terrain d'entente” métaphorique et des lieux réels. Le middle ground est l'endroit du compromis culturel, celui par lequel Amérindiens et Européens (français puis anglais), sans renoncer à leurs cultures et à leurs visions du monde, réussissent à les accorder par le biais de quelques compromis et de quelques malentendus. Les exemples concrets de ce mécanisme sont nombreux : R. White l'utilise par exemple pour décrire le commerce de la fourrure, où la vision européenne du marché et la vision indigène du don se rencontrent pour créer un échange. Les Algonquiens habillent alors leur relation commerciale avec les Français sous la forme d'une logique de lien personnel (R. White rapporte un discours d'un Sauk qui plaidait pour la reconnaissance envers les Français, qui venaient de loin pour les aider) ; de leur côté, les autorités françaises administrent les prix des denrées, leurs partenaires prenant volontiers une hausse pour un acte d'hostilité ou d'abandon. Chacun continue à parler son langage (le marché pour les uns, la reconnaissance et le don pour les autres) mais tout en l'adaptant. Des développements passionnants sont consacrés au droit pénal (punitif pour les Occidentaux, réparatif pour les Amérindiens). On reconnaît la très grande qualité du livre à la circonstance que R. White ne se réfugie pas dans de vagues déclarations sociologiques comme on en trouve souvent dans l'histoire telle qu'elle s'écrit aujourd'hui (”identités fluides”, “négociation de la culture”) mais cherche plutôt à faire ressentir, par le travail au plus près des sources, la réalité de ces accommodements frontaliers.
Ce cadre d'explication général n'empêche pas R. White de prêter une attention assez serrée aux évolutions dans le temps, et de faire valoir les ruptures. Cet exercice est particulièrement intéressant en tant que lecteur français, mal informé sur le premier empire colonial de mon pays (comme le sont, je suppose, la plupart des Français). En décrivant l'action française dans le “pays d'en haut” (pour le dire très vite, les Grands Lacs), R. White s'éloigne des stéréotypes sur la colonisation française en montrant des Français plus adaptables que les Anglais, plus enclins à jouer un rôle de médiateur, et qui seront regrettés par leurs “alliés” algonquiens après la guerre de Sept ans.
Enfin, outre cette double vision — transversale et chronologique, — l'étude des sources dégage souvent des perspectives qui dépassent même les intentions de l'auteur. On peut penser, par exemple, aux avis divergents des colons américains au-delà des Appalaches sur la magie indienne, et aux débats parfois étonnants à ce sujet (le Quaker John Anderson, après avoir survécu à un sort censé le tuer, pense avoir démontré l'inanité des superstitions locales ; mais l'archi-sorcier se défend en blâmant la consommation de sel des Européens, qui les protège des sortilèges !). Pensons aussi, au début, à cette rébellion féminine face au mariage politique de la fille d'un chef (cinquante femmes se réunissent dans l'église pour s'opposer à la décision — on se croirait chez Aristophane) ; ou, à la fin, cette étonnante tentative de certains Amérindiens, opposés aux jeunes États-Unis d'Amérique, de définir comme grand clivage l'opposition entre “couleurs” (races), afin de transcender les querelles entre confédérations et tribus…