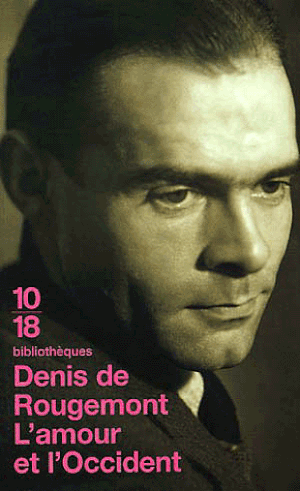Denis de Rougemont flétrit à plusieurs reprises les érudits pinailleurs qui ont critiqué son ouvrage (et consacre même à leur réfutation un volumineux post-scriptum, écrit quarante ans après la première édition : il y a là un petit goût d'obstination…). Sans être érudit, je me vais me joindre à la cohorte.
L'Amour et l'Occident a pour principal tort de traiter sur le mode historique un sujet qui se serait mieux prêté à une approche philosophique ou (plus franchement) apologétique. Il voit dans la passion amoureuse un phénomène historique dont l'origine pourrait être précisément tracée à la rencontre d'une tradition religieuse gnostique, celle du catharisme, et d'une rhétorique poétique, celle des troubadours (qui, par une bizarre transitivité, se voit ramenée à celle de Tristan et Iseut). Si l'approche historique de la sensibilité peut être féconde, il est douteux que l'on puisse ramener avec tant d'exactitude l'apparition d'une vogue sentimentale à un événement précis.
L'analyse devient d'autant plus fragile lorsqu'on considère que les faits qui la fondent sont eux-mêmes douteux (“est-ce vraiment sérieux ?”, serait-on tenté de s'interroger avec Sartre, qui se posait la question dans une critique publiée par le magazine Europe et reprise dans le volume Situations I). Les liens entre trobar et catharisme, pourtant centraux dans L'Amour et l'Occident, sont au mieux allusifs dans le fonds documentaire. De Rougemont les défend certes avec adresse, notamment dans une excellente page où il compare les liens entre catharisme et trobar à ceux qui unissent psychanalyse et surréalisme — nulle part explicites, partout éclatants. Pourtant, la littérature historique sur la tradition courtoise montre assez la légèreté de ce rapprochement : s'il n'est pas exclu que quelques troubadours aient croisé le catharisme ou aient été influencés par ses croyances, il serait difficile d'attribuer aux quelques trois cents troubadours (d'après Michel Zink, spécialiste du sujet) une source d'inspiration commune dans les idées hétérodoxes des cathares, d'autant que ceux-ci ne composaient que 2 à 5 % de la population de leur aire de répartition (selon Jean-Louis Biget). Cette fragilité s'accentue lorsque Rougemont convoque des idées plus farfelues (mais toujours l'air de ne pas y toucher, par l'allusion ou la suggestion immédiatement nuancée) : une inspiration orientale directe des cathares (là où elle ferait plutôt l'objet d'une intermédiation bogomile) ou l'idée selon laquelle le trobar clus, poésie hermétique du Midi, serait en fait un code ésotérique. On n'est alors pas loin du Da Vinci Code.
Autre source d'étonnement : L'Amour et l'Occident est, dans son écriture, assez lourd et disjoint, ce qui forme un saisissant contraste avec ses chiffres de vente mirifiques : presque 200 000 en France dans les cinquante premières années de vie de l'ouvrage, réédité plusieurs fois, et 400 000 dans le monde.
Malgré tous ces griefs, il faudrait être insensible pour ne pas reconnaître certains mérites de L'Amour et l'Occident. L'intuition qui relie la vision du monde gnostique à l'eros (qui, sous un couvert sensualiste, nie en fait le monde) est puissante. Le court livre consacré à la guerre est intéressant, même s'il son lien avec l'ensemble n'est pas évident. Cette qualité d'intuition aurait sans doute été mieux servie si elle avait été plus franchement inscrite, comme le suggère Sartre dans sa critique de l'ouvrage, dans une réflexion ouvertement “compréhensive”, c'est-à-dire abordant une époque par des rapprochements d'ensemble sans suggérer des causalités impossibles.
PS : on pourra néanmoins prendre pour prétexte la lecture de L'Amour et l'Occident pour découvrir le parcours intéressant de Rougemont. Personnaliste avant-guerre, il a fait partie après-guerre des premiers avocats d'une “Europe des régions” contre “l'association de misanthropes” que constituait une Europe intergouvernementale. L'idée de l'Europe des régions étant un des spectres agités par le discours anti-UE, alors même qu'elle n'a pour ainsi dire trouvé aucune traduction concrète, il est intéressant d'en retrouver ainsi les sources intellectuelles (qui sont, sans surprise, très éloignées de la véritable construction européenne).