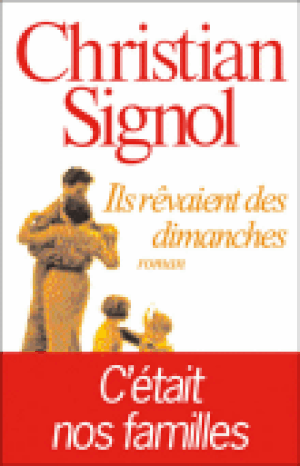Préliminaire 1 : Je l'ai déjà écrit moult fois mais je préfère le repréciser à nouveau. Dans ma façon de faire sur SC, la notation ne se veut en rien être le reflet de la qualité d'une œuvre et encore moins d'un auteur. Je ne m'en estime tout simplement pas le droit. Dans mon esprit, la notation n'est que la synthèse de mon appréciation c'est-à-dire, entre autres, de l'intérêt plus ou moins grand que j'y ai trouvé, de la "beauté" ou de la "grandeur" des personnages décrits, de la portée de l'histoire racontée. La notation est aussi la mise en perspective avec d'autres oeuvres de l'auteur ou d'auteurs analogues.
Préliminaire 2 : Dans la littérature, j'aime essentiellement le genre du roman où l'auteur nous conte une belle histoire, nous introduit dans un contexte donné et nous fait part de ses idées, son appréciation de telle ou telle situation, d'un message, pourquoi pas. Bien évidemment, je suis certain que le romancier introduit des personnages qu'il connait et qui lui sont chers ou au contraire qu'il n'aime pas. Il est évident que la première source d'inspiration d'un romancier, c'est sa propre vie et les gens qu'il côtoie, son propre ressenti, ses propres idées. Bref son vécu.
Mais il y a un genre que j'aime moins ou plutôt qui m'intéresse moins, c'est celui de l'autobiographie au sens large. J'ai toujours l'impression que le roman perd une de ses dimensions essentielles qui est celle de l'imagination.
Bien sûr, on va me dire que rien ne vaut le témoignage direct, factuel "je vous le dis parce que je l'ai vécu, donc c'est vrai"… Oui, bien sûr. Mais si je fais de l'introspection moi-même et qu'il me prenne l'envie de faire de même – rendre hommage à mes grands-parents, par exemple – est-ce que je dirais tout, quel serait le sens que je donnerais ? Clairement, je réponds non à la première question et il est bien probable que le sens à donner, au-delà du fait de porter témoignage, serait celui de générer de l'empathie voire de l'admiration chez le lecteur. Finalement, quelque soit la façon de faire de l'auteur, je suis toujours gêné de lire une autobiographie et je préfère nettement la version romancée plus anonyme même si le romancier introduit – sans le dire – des parts importantes de sa vie. Dans ce cas, je lui laisse le loisir (la liberté) de choisir ce qu'il veut introduire de vécu ou de fantasmé. Il m'est alors plus facile de m'introduire, de m'assimiler au roman. Ce qui n'est pas possible dans l'autobiographie ou la description d'une vie réelle.
Mais revenons à "Ils rêvaient des dimanches" qui est le premier tome d'un diptyque "C'était nos familles": c'est l'histoire d'Eugénie et de son fils Germain, c'est-à-dire l'aïeule et le grand-père maternel de l'auteur qui vécurent dans des conditions très dures voire inhumaines au début du vingtième siècle dans une région pauvre limitrophe entre Lot et Cantal. C'est l'histoire de la lente évolution d'une vie qui tient du servage pour peu à peu gagner une liberté, une indépendance au prix d'efforts inouïs et de travail sans relâche. Eugénie n'a eu de cesse d'acquérir une respectabilité après avoir été "séduite et engrossée" par le fils du chatelain chez qui elle était placée puis humiliée par sa propre famille qui l'a rejetée. Ce qui est admirable c'est sa propre prise en main et son objectif de fer de se sortir seule de sa situation. J'aime bien l'expression qu'emploie Christian Signol pour signifier qu'acquérir son indépendance demandait de l'argent qu'Eugénie n'avait pas malgré les économies accumulées année après année : "elle avait tout simplement acheté un mari". C'est certainement le meilleur compromis pour récupérer une dignité et une respectabilité. Un mariage arrangé entre deux familles n'est guère autre chose non plus. Ce qui est admirable c'est l'esprit de décision et l'analyse clairvoyante de la situation qui sont les signes indiscutables d'une forte personnalité.
En ce qui concerne Germain, le fils d'Eugénie, rien ne lui sera donné et le peu qu'il aura, il l'aura payé au prix fort. Que ce soit l'humiliation (à l'école) de ne pas avoir de père, les placements loin de sa mère dès l'âge de douze ans, les débuts difficiles de l'apprentissage du métier de boulanger puis surtout la guerre de 14-18 où il fut gravement blessé et surtout gazé. Son indépendance, il va la gagner, certes, mais là aussi au prix d'un travail acharné.
Rien d'étonnant qu'Eugénie et Germain aient eu des caractères très durs et trempés. Cela ne pouvait guère être autrement pour survivre dans les conditions précaires qui étaient les leurs.
Au-delà de toutes mes réticences liées au genre de livre, Christian Signol, signe ici un magnifique hommage à ses ancêtres dont il a patiemment décortiqué et conté la vie.