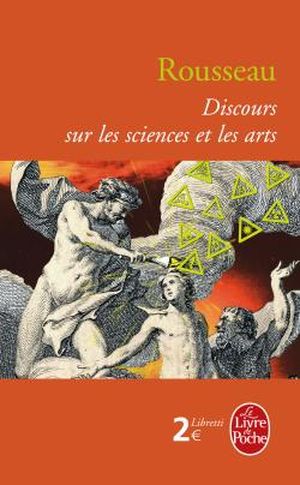La science et les arts comme fruits de nos vices.....
Bonjour à tous,
Voici encore Jean-jacques qui revient à la charge. Il est tellement génial !!
Moins connu que le "Discours sur l'inégalité" et le "Contrat social" qui en découlera, le "Discours sur les sciences et les arts" de Rousseau est pourtant une oeuvre tout aussi intéressante. Publié en 1750 il s'agit de son premier essai philosophique et, répondant ici aussi -comme pour le "Discours sur l'inégalité"- à une question proposée par l'Académie de Dijon (à savoir si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs) il jette les bases de sa pensée, une vision de la société et de ses conséquences corruptrice de l'homme policé, corrompu par la société civile, et ses moeurs.
En 1749, l'Académie de Dijon met au concours la question suivante : Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Alors qu'il va rendre visite à Diderot prisonnier à Vincennes, Rousseau feuillette le Mercure de France qui publie la question : " Si jamais quelque chose a ressemblé à une
inspiration subite, écrira-t-il plus tard, dans les Confessions, " c'est le mouvement qui se fit en moi à cette lecture ; tout à coup, je me sens l'esprit ébloui de mille lumières ; des foules d'idées vives s'y présentèrent à la fois avec une force et une
confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable. " À la question posée, il répond par la négative et l'Académie couronne son Discours qui connaît un succès foudroyant. Voilà Rousseau célèbre - et aussi attaqué. Mais Voltaire a beau dire que " Jean-Jacques n'est qu'un malheureux charlatan qui, ayant volé une
petite bouteille d'élixir, l'a répandu dans un tonneau de vinaigre ", une force insoupçonnée et sincèrement rebelle apparaît dans ce Premier Discours, une pensée novatrice qui sonne juste et résiste aux sarcasmes. Et la lumière que Rousseau jette sur l'homme et sur le lien social va contribuer à remettre en cause une certaine idée du progrès.
Il n'y mâche pas ses mots :
"L'astronomie est née de la superstition; l'éloquence, de l'ambition, de la haine, de la flatterie, du mensonge; la géométrie, de l'avarice; la physique, d'une vaine curiosité; toutes, et la morale même, de l'orgueil (...) Que ferions-nous des arts, sans le luxe qui les nourrit ? Sans les injustices des hommes, à quoi servirait la jurisprudence ? Que deviendrait l'histoire s'il n'y avait ni guerre, ni tyrans, ni conspirateurs ?"
Pour lui les sciences et les arts sont donc nés de nos vices. Pire : une société qui les glorifie ne peut que sombrer dans le luxe et l'oisiveté. Il n'y a qu'à penser aux salons où se réunissent les intellectuels de son temps et qu'il méprise tant pour voir où il veut en venir. Á leur pomposité il en profite pour opposer les vertus par exemple des Spartiates... Son discours n'est en effet pas sans failles et, sans nier l'importance des arts et des sciences (et encore moins défendre le retour à un état de nature où régnait l'ignorance !) il prêche une forme d'élitisme pour le moins étrange : pour lui de telles activités intellectuelles et artistiques devraient être réservées à ceux-là seuls qui sont vertueux. Sachant que lui-même s'adonnait à la musique, la littérature, la philosophie ou encore la botanique on peut se demander ce qu'il entend par "vertueux".... Mais c' est sans compter sur une deuxième partie du discour qui vient éliminer tous nos doutes. Ce qu' il entend par " Sciences " est l' esprit progressiste de son temps et les faux-savants qui mènent inéluctablement à une société oligarchique et injuste !
Il est bien sûr facile de caricaturer ce Discours, et des lettres où il répond à diverses critiques l'accompagnent et viennent d'ailleurs utilement l'éclairer. Pourtant si Rousseau qualifiera plus tard cet essai, qui lui valut une notoriété naissante et le premier prix de l'Académie de Dijon de "tout au plus médiocre", il me semble que les failles reposent dans la question même plutôt que dans sa réponse. "Le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer les moeurs ?" laisse en effet sous-tendre un scientisme typique des Lumières. Saluons Rousseau pour, au moins, ne pas sombrer dans un tel piège.... Brave Jean-Jacques.....
« Voilà comment le luxe, la dissolution et l'esclavage ont été de tout tems le châtiment des efforts orgueilleux que nous avons faits pour sortir de l'heureuse ignorance où la sagesse éternelle nous avoit placés. Le voile épais dont elle a couvert toutes ses opérations, sembloit nous avertir assez qu'elle ne nous a point destinés à de vaines recherches. Mais est-il quelqu'une de ses leçons dont nous ayons sû profiter, ou que nous ayons négligée impunément ? Peuples, sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la science, comme une mere arrache une arme dangereuse des mains de son enfant ; que tous les secrets qu'elle vous cache sont autant de maux dont elle vous garantit, et que le moindre de ses bienfaits. Les hommes sont pervers ; ils seroient pires encore, s'ils avoient eu le malheur de naître savans.».....
Non, les sciences et les arts n'épurent pas les mœurs ; ils sont bien plutôt l'indice et la cause de la décadence des nations, ce que l'Histoire viendrait confirmer par de nombreux exemples : le peuple romain, rugueux et authentique, a triomphé des Carthaginois raffinés ; c'est après un siècle de haute culture qu'Athènes et les autres cités grecques sont tombées sous le joug Macédonien. Constantinople, enfin, qui conservait les arts et les sciences comme un trésor durant le mâle Moyen-Âge, a été le théâtre des plus sombres complots. C'est que les sciences et les arts ne rendent pas vertueux : ils ne font que pousser les hommes à singer la vertu par la politesse, et à cultiver leur paraître social, qui excuse toutes les vilénies si elles sont exécutées avec esprit... Voilà ce qui nous éloigne de l'authentique vertu, et de la patrie chère aux Romains. Sciences et art, indissociables du luxe et de l'oisiveté, naissent des défauts humains, et corrompent le bon goût. L'oisiveté qu'impliquent ces activités contemplatives ôte à la construction du bien commun des hommes qui eussent été utiles à leur patrie et à l'humanité. Rousseau répond donc par la négative à la question posée par l'Académie : les sciences et les arts constituent un danger pour le caractère des hommes ; le bien de l'humanité est à chercher dans la rudesse des mœurs, une préfiguration du concept d'état de nature...
Ce discours, très vif, se lit de façon fluide ; contrairement à beaucoup d'écrits philosophiques, ici, la thèse repose moins sur une succession de déductions que sur une suite d'exemples historiques (les notes sont, sur ce point, très utiles), et de références à Montaigne. On suit donc Rousseau sans mal dans son argumentation. Je pense qu'on peut recommander ce livre pour s'initier à la philosophie, tant sa facilité d'accès et son refus de l'opinion communément admise en font une lecture plaisante. En tout cas, dans sa première partie.
Néanmoins, dans la seconde partie de son essai, il explicite son jugement et critique, très fortement, le progressisme, le culturo-mondain, l' affaissement de la pensée de son temps, l' hypocrisie des mondains ( dont voltaire qu' il accuse d' être un hypocrite et un faux philosophes ), etc.... Il critique également, les deux versants de la pensée de son époque qui sont des escrocs de la pensée ( hobbes et la déchéance de l' homme par le péché oroginel, etc.... ).
Lorsqu’en 1749, il participe au concours ouvert par l’académie de Dijon sur le thème « Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs » (il obtiendra le premier prix), c’est pour répondre avec force par la négative. Sa conclusion est que les sciences, les lettres et les arts ont surtout contribué à la « corruption des moeurs » et que leur prétendu « progrès » s’est partout traduit par un abaissement de la morale : « Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. » Prendre une telle position, écrit Frédéric Lefebvre, « c’était déjà se tourner contre la Cour et les salons […], le paraître plutôt que l’être […] ». C’était surtout s’en prendre radicalement à l’idéologie du progrès, qui sous-tend tout le projet des Lumières. Car, dans la querelle des Anciens et des Modernes, Rousseau se situe sans équivoque du côté des premiers.
Depuis son enfance, d’ailleurs, il admire par-dessus tout la République romaine (« A douze ans, j’étais un Romain ») et c’est à l’Antiquité qu’il se réfère tout au long de son oeuvre pour exalter la citoyenneté, la vertu antique et la patrie. « Sans cesse occupé de Rome et d’Athènes, écrira-t-il dans ses Confessions, vivant, pour ainsi dire, avec leurs grands hommes, né moi-même citoyen d’une République et fils d’un père dont l’amour de la patrie était la plus forte passion, je m’enflammais à son exemple ; je me croyais Grec ou Romain. »
Les Lumières voyaient dans le développement du commerce un moyen, non seulement d’accroître la richesse, mais aussi de faire disparaître la guerre : la négociation intéressée, profitable à tous, devait se substituer peu à peu à la confrontation armée. Rousseau dénonce au contraire la corruption et les artifices des sociétés vouées au commerce et assure qu’à l’économie de production, qui s’attache au profit et fait de l’argent le moteur de la société, il vaut mieux préférer l’économie de subsistance, qui ne consomme que ce qu’elle produit. C’est pourquoi il fait l’éloge de l’agriculture, persuadé qu’il est en outre que le goût de la terre se confond avec l’apprentissage de la patrie : « Le meilleur mobile d’un gouvernement est l’amour de la patrie, et cet amour se cultive dans les champs. »
De même, dans le grand débat sur le luxe qui agite tout le XVIIIe siècle, Rousseau s’affiche avec force comme un adversaire de la corruption engendrée par le luxe, au moment même où les « philosophes » en font bruyamment l’apologie. Le luxe « corrompt à la fois le riche et le pauvre, l’un par la possession, l’autre par la convoitise; il vend la patrie à la mollesse et à la vanité ». Sur le plan économique, il prône donc la modération : « Que nul citoyen ne soit assez opulent pour pouvoir en acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre […] Ne souffrez ni des gens opulents ni des gueux. Ces deux états, naturellement inséparables, sont également funestes au bien commun » (Du contrat social).
S’opposant frontalement à la thèse de Bernard Mandeville (la Fable des abeilles, 1714), selon laquelle la recherche égoïste du profit individuel aboutit paradoxalement au bonheur de tous, Rousseau rejette l’idée d’une harmonie sociale spontanée résultant de la libre confrontation des intérêts. « Loin que l’intérêt particulier s’allie au bien général, écrit-il, ils s’excluent l’un l’autre dans l’ordre naturel des choses. » Pour lui, les échanges économiques ne réunissent les hommes qu’en les opposant. Récusant l’idée d’un fondement économique de la société, Rousseau en tient pour un fondement strictement politique et, à l’encontre des physiocrates comme des philosophes des Lumières, affirme fermement la nécessaire subordination de l’économie au politique.
Cet essai passionnant, stimulant, nous force à porter un autre regard sur la culture, ce qui s'avère toujours salutaire, la remise en question étant la meilleure façon d'apprendre à penser par soi-même. Et même s'il est presque impossible, en apparences, si on le lit très mal, ou trop vite, d'adhérer à sa thèse, du moins celle-ci enrichit-elle indéniablement notre petit monde intérieur.....
Bonne lecture !! Et gloire, à ce cher Jean-Jacques. Portez vous bien. Tcho.