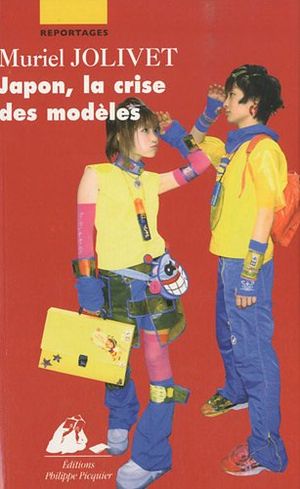Critique initialement publiée sur mon blog : http://nebalestuncon.over-blog.com/2017/12/japon-la-crise-des-modeles-de-muriel-jolivet.html
FOLLE JEUNESSE
Muriel Jolivet est sociologue ; elle vit au Japon, où elle enseigne, depuis 1973, et, après sa thèse intitulée L’Université au service de l’économie japonaise, elle a livré plusieurs ouvrages d’importance, parmi lesquels il faut semble-t-il singulariser Un pays en mal d’enfants : crise de la maternité au Japon, mais aussi d’autres titres encore, comme, dans la même collection que celui qui nous intéresse aujourd'hui, Homo japonicus – que je lirai prochainement, d’autant qu’il sera sans doute instructif de l’envisager en parallèle d’une autre lecture, en cours, et toujours dans la même collection, à savoir Japonaises, la révolution douce, d’Anne Garrigue.
Ladite collection s’intitule donc « Reportages », et j’imagine que c’est à relever, car cela explique sans doute que la forme, sinon le fond, ne soit pas forcément toujours très conforme aux critères éventuellement austères de la sociologie universitaire. C’est peut-être plus sensible encore au regard de Japon, la crise des modèles, dans la mesure où il s’agit largement d’une étude des représentations, telles qu’exprimées dans la presse japonaise et autres essais en forme de best-sellers que produit à la chaîne une société anxieuse de son image et inquiète quant à son avenir – ici sur un sujet qui l’angoisse beaucoup (mais pas forcément beaucoup plus que le vieillissement de la population, la dénatalité ou encore l’identité nationale – mais au fond tout est lié), à savoir sa folle jeunesse.
Or le tableau initial est très noir, et, si Muriel Jolivet, sur ces bases plus ou moins livresques, complétées bien sûr par des entretiens et des études davantage statistiques, construit un discours scientifique, il n’en reste pas moins que le matériau premier, dans ces articles de presse et ces essais éventuellement de supermarché, est porteur de connotations morales envahissantes, dès lors guère portées à rendre véritablement sereine l’étude du problème – à considérer que la jeunesse soit un problème. Les termes dépréciatifs sont très souvent de la partie, et parfois très francs du collier : on parle ici de « parasites », de « chiens battus » (makeinu), et tout un vocabulaire encore (femio-kun, hikikomori, NEET, onibaba, otaku, « herbivores »…), lourd de reproches, tantôt explicites, tantôt implicites mais qui ne font guère de doute pour autant.
Maintenant, ces représentations constituent un sujet d’étude en tant que tel – mais je suppose qu’il faut donc mentionner d’emblée que Japon, la crise des modèles, avant d’être une étude sur la jeunesse japonaise, est peut-être une étude sur l’image anxiogène que la société japonaise conçoit de sa propre jeunesse.
En même temps, il y a bien ici comme un jeu sur les représentations, qui dépasse celles que le Japon se fait de lui-même, pour englober celles que l’Occident, et la France notamment, est toujours porté à susciter et entretenir concernant ce pays antipodal qui incarne tout à la fois un exotisme ultime propice aux simplifications outrancières, et en même temps le miroir fêlé de nos propres sociétés, guère rassurées elles non plus quant à leur avenir, conception dans laquelle le Japon constitue souvent une anticipation à très court terme, en forme de cauchemar qui s’annonce… Mais ça, j’y reviendrai surtout dans un autre compte rendu, consacré au petit ouvrage de Philippe Pelletier Le Japon, histoire et civilisations, dans la collection « Idées reçues » du Cavalier Bleu, lu entre-temps.
Pour l’heure, restons-en donc à Japon, la crise des modèles. Car un dernier point est à avancer, ici ; en effet, et il me faudra y revenir, l’ouvrage de Muriel Jolivet est, d’une certaine manière, scindé en deux temps : la jeunesse, ses problèmes, ses représentations, c’est surtout l’affaire de la première moitié, environ, de l’essai ; mais la seconde s’éloigne parfois de cette thématique, en envisageant des questions consacrées au mariage, à la sexualité, aux rapports entre hommes et femmes… Certains liens existent bel et bien, qui peuvent associer les deux parties – et probablement au premier chef la notion cruciale de « moratoire », sur laquelle je reviens de suite –, mais l’étude et les entretiens, à ce stade, sont très loin de ne porter que sur des jeunes ; en fait, les quadragénaires voire quinquagénaires y ont probablement une place plus importante. Il y a donc, ai-je l’impression, une certaine rupture ici, fond et forme, mais c'est à débattre.
LE MORATOIRE
Le point de départ de cette enquête, cependant, n’est pas issu de la presse à sensation, quand bien même il s’agit déjà semble-t-il d’un ouvrage « à la mode » en son temps : à la fin des années 1970, le psychanalyste Okonogi Keigo s’intéresse ainsi à l’idée d’une jeunesse en « moratoire » ; il ne s’agissait pas tant, semble-t-il, de livrer une étude en forme de constat sur le moment, mais peut-être aussi voire davantage de tenter une certaine prospective – que le cours ultérieur des événements aurait largement validée. C’est aussi, pour Muriel Jolivet, l’occasion de revenir sur sa thèse, datant en gros de la même époque : traitant de L’Université au service de l’économie japonaise, elle s’était forcément intéressée aux jeunes.
Classiquement, on considère l’Université, au Japon, comme un entre-deux presque paradisiaque, entre la scolarité dans le secondaire, frénétique, lourde, focalisée sur les très exigeants concours d’entrée aux universités dans un esprit de compétition impitoyable se traduisant aussi bien dans le bachotage forcené que dans la nécessité de cours complémentaires onéreux, et l’entrée dans la vie active à proprement parler, avec un travail obnubilant qui ne laisse aucune place ou presque à la vie personnelle et familiale – concernant les hommes, du moins ; pour ce qui est des femmes, nous aurons l’occasion de revenir sur le destin des « OL » (« Office Ladies »), et plus généralement sur les discriminations dont elles font les frais en milieu professionnel ; l'entre-deux fait sens également les concernant, mais plutôt comme une brève période de liberté précédant le mariage, plutôt que le travail (au sens professionnel bien sûr).
C’est ici qu’intervient le « moratoire ». L’Université étant une période heureuse, et bien trop courte à cet égard, les jeunes mettent en place de véritables stratégies pour la prolonger – et, à ce stade, on peut d’ailleurs envisager la question au-delà des seuls étudiants en université : c’est la jeunesse japonaise, dans son ensemble, qui « fait durer le plaisir », en repoussant le moment de l’insertion inéluctable dans la vie active. Mais, pour l’heure, l’Université : ces stratégies d’évitement peuvent prendre diverses formes – comme, par exemple, les « études à l’étranger », souvent guère studieuses, et qui consistent surtout à « s’amuser » le cas échéant (le verbe asobu peut signifier aussi bien « jouer » ou « ne rien faire »), même si une expérience à l’étranger peut avoir son importance dans la suite des opérations ; les redoublements calculés se mettant de la partie, le cycle universitaire, de quatre années normalement (deux pour les universités « intermédiaires », « de cycle court », qui semblent surtout être fréquentées par des jeunes femmes destinées à devenir sous peu des épouses et des mères), peut être en gros prolongé jusqu'à une dizaine d’années. On est donc très loin du rythme initialement prévu et longtemps suivi, qui voulait que l’on fasse ses études dans les quatre années réglementaires, pour aussitôt intégrer une entreprise et se mettre au travail, disons vers 22 ans – cette fois, on lorgne sur la trentaine.
Mais cela dépasse le seul cadre des études : le travail en est tout autant affecté, au sens de « véritable » travail. Ainsi, nombre de jeunes, pas bien certains de ce qu’ils veulent (?) faire plus tard, deviennent des « freeters » (mot formé à partir de l’anglais freelance et de l’allemand Arbeiter, en sachant que le mot allemand Arbeit, « travail », désigne au Japon, sous la forme arubaito, les petits boulots précaires) : pendant quelques années, ils enchaînent les jobs dans un cadre assez informel et sans créer de vrais liens – avec le risque que cette situation d’abord volontaire ne les piège et qu’ils ne puissent plus s’en émanciper.
Au-delà ? Il y a encore ceux qui… ne font rien : les hikikomori, bien sûr, mais c’est une forme extrême d’un problème plus prégnant, sur un mode moins spectaculaire ; ainsi, on parle beaucoup des « NEET » (« Not in Employment, Education or Training » ; nîto en rômaji), « parasites » qui vivent toujours chez leurs parents à l’âge de trente ans ou au-delà – du post-Tanguy, pour prendre une référence française ; concernant les femmes, on parle aussi de kaji tetsu hime – pour désigner des jeunes filles qui restent à la maison parentale au prétexte d’aider leur mère (ce qu’elles ne font pas), mais attendent surtout de se marier sans faire quoi que ce soit d’autre d’ici-là ; on y voit parfois une forme féminine du retrait du monde façon hikikomori, qui est quant à lui presque systématiquement masculin, et souvent associé à une certaine violence domestique. Pourtant, l’amae, ou « dépendance affective », y a peut-être sa part, qui a été théorisée par le psychiatre Doi Takeo dans Le Jeu de l’indulgence, y voyant un trait fondamental de la société japonaise, produisant le cas échéant des « adultes » qui demeureraient en fait des « enfants déresponsabilisés »… Dans un autre pays, on parlerait probablement de « syndrome de Peter Pan » ? Mais, ici, c’est sur un mode plus extrême que jamais.
Or ce dernier exemple, via « l’objectif » du mariage (et son corollaire, la procréation), montre que le moratoire ne concerne pas que l’entrée dans la vie active – c’est l’ensemble de la vie sociale en tant qu’adulte qui est ici concerné, et que les jeunes Japonais (pas seulement les jeunes Japonaises, au regard du mariage) semblent toujours un peu plus repousser.
Ce qui stupéfie, choque, irrite leurs aînés, qui ne peuvent tout simplement pas envisager ce mode de fonctionnement, si étranger à celui qui fut le leur dans le Japon des années 1960 et 1970 surtout (les choses commencent à changer dans les années 1980 et 1990, avec la bulle spéculative et son éclatement – enfin, « commencent à changer »… D’une manière très schématique : en annexe, une intéressante « Chronologie de la jeunesse japonaise depuis les années 1960 » vient heureusement atténuer ce discours par trop manichéen). Ils ont dès lors des mots très durs pour cette jeunesse dépravée, fainéante (un bouleversement majeur semble avoir été le moment, dans les années 1990 sauf erreur, où les sondages ont révélé que les salariés japonais considéraient désormais les loisirs comme plus importants que le travail !), et donc une jeunesse égoïste, individualiste, etc. On parle de « parasites », très souvent – et autres qualificatifs très forts et méprisants du même ordre. Ce qui, bizarrement, ne semble en rien contribuer à arranger les choses…
TRIBUS, CODES ET CULTURES
Ce mépris ne se montre probablement jamais aussi cru que dans les discours alarmistes des médias sur les « tribus » de la jeunesse japonaise (et surtout des filles) – car le moratoire est propice au développement, non pas d’ « une » culture, uniforme, homogène, mais de plusieurs ; et, par ailleurs, de cultures très « visuelles », ce qui facilite l’identification – à tous points de vue, interne comme externe.
Quoi qu’en disent les vieillards forcément réacs ulcérés par la décadence de « la jeunesse actuelle », le phénomène n’est sans doute pas tout neuf – l’annexe mentionnée plus haut en témoigne, et j’imagine que l’on pourrait remonter encore au-delà, par exemple avec les moga des années 1920 (abréviation de modan gâru, soit l’anglais modern girls). Mais les médias de masse ont probablement eu leur part dans la mise en avant, au-delà de toute mesure, de ce « problème » ; et ce de manière sans doute très hypocrite, maniant aussi bien le sensationnalisme que la vertu outragée, au travers de l’évocation d’icônes (des chanteuses, par exemple, souvent à l’origine de diverses modes) ou d’émissions de talk-show ou de télé-réalité particulièrement scabreuses.
Ces « tribus » sont innombrables – d’autant qu’elles se subdivisent en sous-groupes, selon une codification très précise, et, donc, « visuelle » : l’apparence extérieure est primordiale dans cette affaire, vécue tantôt comme un moyen d’émancipation (la contrepartie radicale de l’uniforme lycéen, à moins qu’il ne s’agisse justement de le dévoyer au travers de lourdes connotations érotiques, sur la mode lolicon par exemple, ou via les maid cafés, etc.), tantôt, ou plutôt en même temps, comme un moyen d’identification : l’apparence extérieure signifie l’appartenance à un groupe.
Muriel Jolivet s’intéresse surtout aux gyaru (le mot apparait dans les années 1970, et dérive de l’anglais gal ; mais le phénomène contemporain, disons depuis la chanteuse Amuro Namie à la fin des années 1980, est d’une tout autre ampleur), lesquelles forment un groupe complexe, riche donc de sous-groupes très codifiés (éventuellement associés à la musique – la gosuloli, ou « poupée gothique », emprunte originellement à la musique new wave, batcave, etc. –, mais ça n’est pas systématique, et ça peut évoluer très vite en dehors de ce référent de base), et constituent en tant que telles un réservoir inépuisable de moquerie et d’indignation pour les médias japonais – jusque dans les contradictions que ces groupes expriment : suivant l’influence de telle ou telle chanteuse à la mode, ou tarento (de l’anglais talent) d’un autre ordre, gloire éphémère de la télé-réalité, etc., certaines gyaru se font outrageusement belles (en fonction de critères parfois antagonistes – cabine de bronzage contre teint de craie), quand d’autres se font outrageusement laides – les premières sont condamnées pour leur superficialité consumériste et matérialiste, les secondes pour leur scandaleux rejet de leur féminité, d’essence subversive… L’érotisation fréquente de ces mises (par exemple avec le mouvement erokawa – pour ero kawai, « érotique mignonne » – lancé par la chanteuse Kôda Kumi avec ses décolletés osés) suscite les mêmes réactions ambivalentes.
Les hommes sont probablement moins inscrits dans ce genre de mouvements – encore que : comme l’affiche le titre d’un ouvrage à succès, « les hommes aussi veulent être beaux ». Des rock-stars, notamment, et très éphémères le cas échant, peuvent initier chez les mâles des mouvements de mode « visuels », lesquels pourront à leur tour susciter la moquerie voire l’indignation des médias : l’androgynie, tout particulièrement, suscite la raillerie méprisante – des femio-kun, hommes efféminés dits « invertébrés » de la première moitié des années 1990, aux sôshoku dansei plus contemporains, les « herbivores », tranchant sur les canons de la virilité classique japonaise (incarnée notamment par l’acteur Takakura Ken, que Muriel Jolivet avait choisi pour la couverture de Homo japonicus – mais elle évoque également ici Mifune Toshirô, par exemple).
Cependant, ces cultures vont éventuellement au-delà des seuls aspects « visuels », pour englober d’autres préoccupations – encore que la pratique du cosplay constitue un lien marqué et éloquent à cet égard. Via les otaku (dont la définition, dans le glossaire en fin d’ouvrage, risque de ne pas plaire à ceux qui, en France, s’approprient volontiers cette désignation – et je ne leur donnerais pas tout à fait tort), on entrevoit d’autres modes de fonctionnement, supposés, le cas échéant, témoigner d’une forme de retrait du monde, alors même qu’il s’agit pourtant de se rendre dans un lieu de sociabilité théorique, comme les manga kissa, ces cafés où des mangas sont à la disposition des clients, et qui sont ouverts vingt-quatre heures sur vingt-quatre – mais justement : ces établissements témoignent d’un autre aspect du problème, avec les netto nanmin, « réfugiés des cybercafés »… qui y passent leurs nuits parce qu’ils ne sont pas en mesure de payer un loyer. L’inégalité des conditions de vie, et les comportements qui en résultent, font pleinement partie du problème.
BIPOLARISATION DE LA SOCIÉTÉ JAPONAISE ET COMPORTEMENTS À RISQUE
Les médias japonais ne présentent peut-être pas les choses ainsi, s’en tenant à la superficialité « visuelle » des gyaru, qu’ils blâment justement pour cette même superficialité « visuelle », et perpétuant plus ou moins consciemment de vieux mythes toujours prégnants, comme celui faisant du Japon une société homogène, constituée d’une immense classe moyenne – et dès lors le cadre idéal d’une méritocratie où régnerait sans partage l’égalité des chances (la sociologue Nakane Chie, avec La Société japonaise, en 1970, avait contribué à renforcer cette image et à la véhiculer en dehors du Japon, jusqu'à nos jours). Pourtant, l’aspect peut-être le plus problématique de cette « crise » de la jeunesse réside probablement dans la bipolarisation de la société japonaise dont elle témoigne (si elle n’y contribue pas forcément, ou en tout cas pas consciemment) : le mythe de la classe moyenne apparaît bien ici comme l’imposture qu’il est.
Parfois, ce constat semble aller dans le sens des critiques formulées par les médias – au moins superficiellement (eh). Dans un pays qui compte le « groupisme » au rang des « nippologies » garantes de sa spécificité culturelle, l’individualisme des jeunes est forcément scandaleux – et, pour le coup, il est probablement difficile de contester que la jeunesse japonaise s’est engagée sur cette voie. Le contexte culturel de la bulle spéculative, avant son éclatement, a favorisé cette évolution, ou l’a accompagnée, mais, déjà avant, à la fin des années 1970, un romancier à succès, Tanaka Yasuo, avait pu illustrer le mode de vie frivole d’une jeunesse « cristal », hédoniste mais aussi obsédée par les marques, dans une infinie litanie à longueur de pages (on parle ici de « brandaholism ») – au fond, des précurseurs du Patrick Bateman de Bret Easton Ellis, mais les meurtres en moins (pas de chance). Plus que dans la seule apparence « visuelle », qui peut être signifiante au-delà, la superficialité de cette jeunesse tient sans doute à ce consumérisme frénétique et irrésistible – même si, plus récemment, il a trouvé à s’exprimer sur des modes plus filous, via des boutiques et même des chaines dédiées, où l’on trouve des articles de mode « indispensables » à un prix dérisoire. Mais le pouvoir des marques demeure, dans un pays où, à peu de choses près, une femme n’est pas une femme si elle n’a pas un sac Louis Vuitton.
Et c’est probablement une étape importante dans les difficultés auxquelles fait face la jeunesse japonaise – plutôt que les difficultés que la société japonaise reproche par réflexe défensif à sa jeunesse. C’est qu’il y a un revers de la médaille, illustré notamment dans les livres de Murakami Ryû, et ce dès Bleu presque transparent : le romancier livre le tableau pour le moins sinistre d’une jeunesse post-moderne qui est avant tout paumée, avant que d’être superficielle – ou bien dont la superficialité n’est jamais que le symptôme extérieur d’un malaise autrement intime. Le repli sur soi et hors du monde des hikikomori en est une autre facette, mais, au fond, ce sont deux « stratégies » en réaction à une anomie permanente, reflet des contradictions de ce Japon qui, selon le cliché, se veut « entre tradition et modernité », mais dont le double discours se situe pourtant ailleurs – dans un rapport à la réussite impitoyable pour ceux qui en sont exclus ou choisissent de s’en exclure. Non loin se profile la nomenclature, biaisée par la reproduction sociale, qui sépare à jamais les « gagnants » des « perdants », dans la pseudo-méritocratie du néolibéralisme économique.
La réalité de la jeunesse japonaise est plus sombre que l’icônisation de la « jeunesse cristal » hédoniste et désinvolte – au sens, du moins, où les conflits de valeurs et de normes ont des conséquences parfois tragiques. Le destin guère enviable des chanteuses et tarento créatrices de tendances n’est que l’illustration « par le haut » de tendances profondes redoutables, et classiquement jugés « pathologiques », d’une jeunesse lambda qui n’a pas toujours les moyens de ses ambitions, et les a probablement de moins en moins.
La délinquance y a sa part, éventuellement : Mizutani Osamu, dit Yomawari sensei (« le prof qui fait des rondes de nuit ») le constate nuit après nuit tandis qu’il arpente les quartiers chauds de Tôkyô ou de Yokohama – et son portrait est assez fascinant, au passage. Cela peut impliquer la consommation de drogue, ou la violence domestique (celle des hikikomori au premier chef, ou du moins en est-ce la variante la plus notoire). Mais, de manière très concrète, la course après l’indispensable sac Vuitton incite des lycéennes, des collégiennes même, à se livrer à l’enjo kôsai, ces relations dites « assistées », euphémisme navrant quand il ne s’agit pas d’autre chose que de prostitution – ces jeunes filles se vendent littéralement à des hommes bien plus âgés, qu’elles appellent même… leurs « papas ». Certaines, en façade du moins, prétendent juger cette activité avec la même désinvolture qu’elles appliquent à tous les sujets – c’est quelque chose de « normal », un service comme un autre ; et elles ont envie de s’acheter tant de choses…
Ce qui nous amène à un autre problème – ou, plus exactement, à un autre niveau du même problème : l’impuissance, sinon la démission, des parents – dans une société où l’échange entre les générations est de plus en plus problématique (cela vaut aussi pour la génération précédente, avec ces grands-parents ayant perdu leur rôle social traditionnel, et dont le taux de suicide est très élevé). Les parents des hikikomori vivent dans le déni, souvent, mais aussi bien ceux des jeunes filles se livrant à l’enjo kôsai : les indices ne manquent pourtant pas – comment leur fille a-t-elle pu se procurer ce sac à main de marque ? Le plus souvent, ils ne lui poseront même pas la question – et ceux qui osent le faire se verront répondre… qu’il ne s’agit que d’une contrefaçon, bien sûr.
Les conduites à risque sont nombreuses, ici – et tout particulièrement au plan de la sexualité. Le dekikon, abréviation familière de dekichatta kekkon, désigne par exemple « le mariage précipité par un heureux événement » ; décidément, on trouve de ces euphémismes…
GAGNANTES CONTRE CHIENS BATTUS : LE MORATOIRE DES FEMMES
Or le cas des femmes, dans cette problématique, est singulier. Les concernant, l’opposition entre « gagnantes » (kachi gumi) et « perdantes » (make gumi) ne concerne en effet pas tant la « réussite » sociale (professionnelle et pécuniaire, s’entend), ni même l’apparence au spectre rigide des critères du brandaholism, elle fait avant tout intervenir un autre paramètre crucial : le mariage, et (donc) le fait d’avoir des enfants.
Car les deux vont forcément de pair : au Japon, on se marie pour avoir des enfants, aucune ambiguïté à cet égard. Or le taux de nuptialité japonais se situe à 95 %, record mondial, tandis que les naissances hors-mariage, sauf erreur, représentent moins de 2 % des naissances totales – mais voilà : le taux de natalité du Japon est aujourd'hui extrêmement faible, à 1,46 enfants par femme… Je reviendrai sur cet aspect précisément un peu plus loin. Mais on comprendra donc déjà que le mariage implique une autre forme du « moratoire », pour les femmes au premier chef, mais où les hommes aussi peuvent avoir leur part.
Le lien se fait donc tout naturellement – et, en même temps, à ce stade, Muriel Jolivet sort du cadre précédent de son étude, à savoir la jeunesse japonaise, pour envisager la condition des femmes japonaises sans que le critère de l’âge intervienne forcément, même s’il serait plus juste de dire qu’il intervient mais d’une façon différente, justifiant que les entretiens, par exemple, impliquent bien plus souvent des quadragénaires et quinquagénaires que des jeunes femmes. Vers le milieu de l’essai, un long chapitre sur les femmes et leur rapport tant au travail qu’au mariage s’impose donc, dans cette optique (qui est aussi, je suppose, une manière de revenir à Un pays en mal d’enfants : crise de la maternité au Japon ?) ; mais il est suivi de deux autres, sur les hommes (revenir à Homo japonicus ?) et certaines « tendances » (façon de parler…) du couple et de la sexualité (union sexless, prostitution masculine, etc.), qui relèvent bien de « la crise des modèles », mais guère de la jeunesse ou du « moratoire » (à vrai dire, ce dernier chapitre m'a paru à la limite du hors-sujet, mais j'imagine que ça se discute).
Scoop : la société japonaise est très sexiste, et très patriarcale (la société française l’est aussi, assurément, mais je crois quand même qu’on se situe là à un tout autre niveau). Les choses évoluent, sans doute, mais lentement – et peut-être plus lentement encore qu’on ne voudrait bien le croire ? L’idée que les femmes s’émancipaient a été répétée en bien des périodes différentes (durant les années 1990, notamment), mais les résultats demeurent assez minces aujourd'hui, et le mariage et la procréation demeurent peu ou prou l’horizon indépassable des femmes japonaises.
Des efforts ont certes été entrepris, au plan législatif notamment, mais la société a pu s’y montrer récalcitrante, au point d’en annuler tous les effets attendus. En témoigne la législation du travail : depuis 1986, la loi dite « EEOL » (pour « Equal Employment Opportunity Law ») a pour objet de permettre aux femmes d’accéder aux emplois dits « généralistes » (sôgôshoku) dans les mêmes conditions que les hommes, ceci afin de leur permettre d’échapper au « placard » des emplois de secrétariat (ippanshoku). Mais les résultats sont maigres : dans les faits, l’emploi féminin demeure aujourd’hui largement restreint aux activités de secrétariat, qui sont sans avenir. On désigne ces femmes (ou on les désignait, car l’expression semble enfin jugée un brin problématique, tout de même) par l’expression « OL », pour « Office Ladies », manière de signifier l’inutilité professionnelle de leurs fonctions – elles n’étaient jamais, et demeurent peut-être, que des plantes en pot, décoratives et sans autre objet, sinon servir le thé : concrètement, les « OL » sont un vivier de femmes « prêtes à marier » ; elles trouveront leur époux dans l’entreprise, rapidement, et cesseront alors de « travailler », sinon dès le mariage, au plus tard à la naissance du premier enfant. Parfois, ensuite, quand les enfants auront grandi (sans que le père ne s’en occupe, son travail lui prend trop de temps), les femmes reviendront sur le marché de l’emploi, mais, à ce stade, elles ne pourront occuper que des emplois très précaires, et quasi systématiquement à temps partiel. Avant comme après le mariage, elles n’ont donc aucune opportunité de faire carrière – elles n’ont dès lors guère d’autre choix que de se consacrer à la famille, à l’époux, aux enfants.
Il y a des exceptions – des femmes, militantes ou pas, qui, en travaillant d’arrache-pied, et à la condition de digérer (verbalement du moins) que l’avancement de leurs collègues masculins même plus jeunes et moins compétents ira bien plus vite, finissent parfois, très éventuellement, et en forçant le destin, par obtenir un poste « masculin » et y gagner un revenu décent (néanmoins bien inférieur, d’un tiers environ sauf erreur, à celui de leurs pairs mâles, même avec moins d’ancienneté et de compétence donc). Mais, dans tous les cas ou presque, cela a impliqué de « sacrifier » la famille et le mariage – en les repoussant « à plus tard », un « plus tard » qui a pu au fil des années se transformer en « jamais ». Le moratoire intervient à nouveau ici, et sans qu’il soit besoin de s’en tenir à ces très rares cas de « réussite professionnelle ». Les jeunes Japonaises, à en croire les sondages, souhaitent toujours se marier, mais « plus tard » (cette fois, ce « plus tard » n’est pas forcément aussi radical que le précédent, mais il a par contre l’indétermination de celui des freeters, concernant leur « véritable » emploi) ; d’ici-là, elles ont envie de travailler un peu « pour elles », et de s’amuser – vous vous doutez de l’avalanche de critiques que cela leur vaut…
Et ces quelques femmes qui ont fait carrière en milieu masculin, envers et contre tous, ne sont certes pas épargnées par ces jugements de valeur, bien au contraire. La société japonaise (Anne Garrigue, dans Japonaises, la révolution douce, à lire en parallèle à ces développements de Japon, la crise des modèles, parle souvent de « Japan Inc. ») demeure rétive à la réussite professionnelle des femmes. Aussi, quand on parle des femmes, les « gagnantes » (kachi gumi) ne sont certes pas celles qui parviennent à occuper un bon poste et bien rémunéré, mais les seules femmes qui sont « bien mariées » (le critère du portefeuille du mari est donc autrement important, et souvent décisif dans les motivations du mariage – la sécurité matérielle joue au premier plan) et qui ont des enfants ; les « perdantes » (make gumi), au contraire, sont les femmes qui n’ont ni mari, ni enfant, passé un certain âge (qui a sans doute reculé un peu, effet du moratoire, mais le critère demeure discriminant). Sur la base de l’expression make gumi, on a brodé (Sakai Junko, en 2003, plus précisément), le qualificatif de makeinu, soit « chien battu », qui, semble-t-il, peut aussi bien être employé avec un certain mépris à l’encontre de ces femmes qui, à quarante ans environ, ne sont pas « casées » et ne le seront probablement jamais, que revendiqué par certaines d’entre elles comme un blason de leur indépendance et de leur liberté. D’autres expressions sont employées pour les désigner, qui parlent d’elles-mêmes : onibaba, par exemple, soit « sorcières »…
Cependant, ces quelques cas, même dénigrés, témoignent bien de ce que les choses changent, à leur rythme de tortue. Plus significatif, peut-être, est le fait que le « moratoire » a déjà produit ses effets en repoussant l’âge du mariage et de la naissance du premier enfant… Et c’est justement ce qui pose problème à la très mâle société politique (les femmes qui font carrière en politique sont aussi rares, voire davantage, que celles qui ont une carrière professionnelle, et pour les mêmes raisons, en gros) : elle est en effet obnubilée par le vieillissement de la population japonaise, le problème n° 1 à l’heure actuelle. Et si l’allongement de la vie y a comme de juste sa part (qui entraîne son lot de difficultés voire de drames, notamment les suicides de personnes âgées que j’avais rapidement mentionnés plus haut), la crise du mariage et surtout de la natalité (rappelons ce taux très bas de 1,46 enfants par femme) attirent bien plus l’attention (en l’absence, encore aujourd'hui, d’un vrai débat sur l’immigration, qui demeure très minoritaire alors que le Japon en aurait cruellement besoin, plus que jamais). Les hommes politiques, dès lors, ne sont pas les derniers à reprocher aux femmes « de nos jours » leur individualisme, leur égoïsme, que traduit leur refus de s’impliquer dans leur rôle « traditionnel » (pour ne pas dire « naturel ») en épousant un homme (qui, lui, travaillera, « à l’extérieur »), et en lui donnant (et au Japon) des enfants, seuls comportements honorables en temps de crise, et nécessaires à la réussite nationale…
La pression sociale demeure donc extrêmement forte, qui pèse sur les femmes japonaises – le moratoire a joué, le mariage se fait davantage « sous conditions », mais il demeure pour la plupart le seul rôle social envisageable.
ET LES HOMMES…
Et les hommes, dans tout ça ? Ils y ont donc forcément leur part, et le tableau n’est guère flatteur, c’est peu dire – dans la lignée de ce que je viens d’évoquer concernant le sexisme patriarcal de la société japonaise, dans l’entreprise comme à la Diète et au gouvernement, mais aussi au-delà, bien au-delà.
Mais « la crise des modèles » concerne aussi les hommes : à l’icône jugée intangible de la virilité japonaise ont pu succéder d’autres approches, moins « dures »… au point où le reproche narquois concernant ces hommes « gentils » et « serviables » n’émane certes pas que des autres hommes plus conservateurs, mais tout aussi bien des femmes.
Par ailleurs, ils ont eux aussi leur rôle à l’égard du moratoire – celui du mariage, s’entend : les jeunes hommes japonais, de plus en plus, n’accordent pas forcément une grande importance au mariage, et donc à la procréation, qu’ils tendent eux aussi à repousser « à plus tard ».
Là encore, les critiques vont bon train : aux reproches habituels concernant l’individualisme et l’égoïsme s’ajoutent d’autres encore, stigmatisant leur « immaturité » (un autre stade de l’amae ?), leur « mollesse », leur refus de s’engager et « d’assumer/assurer »… Ainsi des « herbivores » (sôshoku dansei), qui auraient pris le relais des hommes efféminés des années 1990 (femio-kun), ainsi que les qualifie Fukuzawa Maki dans un best-seller en forme de « guide illustré des hommes de l’ère Heisei » en 2003 – en les opposant bien sûr aux « carnivores », soit aux hommes virils, aux « vrais » hommes, devine-t-on.
Et ces critiques peuvent donc être également le fait des femmes – ce qui ne paraitrait éventuellement paradoxal qu’à la condition d’y regarder de loin.
Mais je dois avouer, à ce stade, que le très pertinent et tout à fait passionnant essai de Muriel Jolivet, sur la durée, m’a tiré ici quelques soupirs, à l’occasion. Entendons-nous bien : l’autrice sociologue sait de quoi elle parle, elle vit au Japon et étudie la société japonaise depuis plus de quarante ans, ce n’est pas à moi, couillon ignare qui n’ai lu que deux, trois bouquins sans même la moindre garantie d’y avoir compris quoi que ce soit, de pointer du doigt des « failles » dans son analyse, que je ne serais de toute façon même pas en mesure de simplement identifier s’il y en avait. Par ailleurs, le constat global d’une société sexiste et patriarcale est indéniable – c’est la base de tous les autres raisonnements, et elle est on ne peut plus assurée. Enfin, j’évite de manière générale de la ramener dans ces débats bien dans l’air du temps, notamment sous risque de mansplaining, comme on dit… Or ici je suppose que c’est plus ou moins ce que je vais faire. Hum…
Bref : mon petit problème, dérisoire. Comme dit d’emblée, cette étude fait la part belle aux représentations, telles qu’elles s’expriment dans les médias japonais et les essais best-sellers. Sur l’ensemble de l’étude, les cas ne manquent donc certes pas, où l’on est confronté aux jugements de valeur (méprisants, hostiles) desdits médias, etc., quand ils traitent des jeunes et surtout des femmes – les premières cibles de ces attaques, très loin devant ; que le même constat s’applique en définitive aux hommes, très loin derrière, n’est donc pas en soi problématique. Ce qui m’a fait hausser le sourcil, c’est que j’ai parfois eu l’impression, à ce stade, que les développements portant sur les hommes japonais (bien plus brefs que ceux qui précèdent), dans leur approche, n’étaient finalement pas si éloignés de ces jugements de valeur – mais c’est peut-être, et même probablement, un biais de ma part.
Mais voilà, j’ai eu du mal à me défaire de ce sentiment que la distance n’était ici plus suffisamment de mise, parfois, au risque de la simplification. Quelques exemples, qui valent ce qu’ils valent (sans doute pas grand-chose) : quand une femme repousse le moment de se marier, c’est signe de sa liberté et de son indépendance ; mais quand un homme repousse le moment de se marier, c’est signe de son immaturité et de son refus de s’engager. La misère voire la détresse sexuelle qui en découle éventuellement n’est du coup pas envisagée de la même manière : celle des femmes est une véritable souffrance, conséquence du manque d’implication des hommes (l’ultime chapitre s’intitule « Quand le mari n’assume pas », et traite de manière périphérique des couples sexless et de la prostitution masculine) ; celle des hommes ne témoigne jamais que de ce que la réalité n’entretient aucun lien avec leurs fantasmes beaufs, sciemment entretenus dans les « enquêtes » vulgaires de la revue SPA!, à la lecture aussi des plus mauvais mangas, et à la fréquentation assidue des maid cafés. Qu’une femme attache une importance primordiale au revenu et à la sécurité matérielle pour décider de son mariage est dans l’ordre des choses, et n’appelle pas de jugement ; qu’un homme attache de l’importance à la jeunesse pour décider de son mariage est parfaitement navrant, ridicule et insultant. Les femmes prostituées sont bien des victimes des hommes leurs clients, mais les prostitués masculins (les boy, au sens strict, éventuellement les host de manière plus ambiguë) sont quant à eux des manipulateurs qui abusent de leurs clientes, les vraies victimes en l’espèce (même après avoir décrit les conditions de vie terribles des host débutants « hébergés » dans des dortoirs où on les entasse – je note au passage que le cas des host, dans l’ensemble des 300 pages de cet essai, est le seul moment où l’autrice évoque, et en quelques lignes à peine, l’homosexualité, et donc uniquement masculine ; ce que je n’ai pu m’empêcher de trouver un brin étonnant au regard du propos de cette étude), etc.
Il y a sans doute du vrai dans tout cela – essentiellement du vrai, d’ailleurs ; peut-être même rien d’autre. Mais j’ai regretté que l’essai, ici, n’use pas des mêmes précautions qu’avant concernant ce genre de jugements de valeur. En même temps, c’est peut-être ce que l’autrice a fait dans Homo japonicus, que je compte lire prochainement, et peut-être cela me permettra-t-il de balayer mes préventions-réflexes, que ces quelques lignes dont je ne suis pas fier expriment avec une naïveté de bon aloi ; cependant, je ne me sentais pas de faire un compte rendu honnête sans faire part de ces quelques soupirs – d’où ces « explications » assurément embarrassées.
Bien sûr, il y a une « explication » bien plus simple à cette réaction – qui ne concerne que mon médiocre moi, et en rien l’essai lui-même : c’est que, même avec toute cette distance aussi bien géographique que culturelle, je m’y suis régulièrement reconnu. La chose étonnante – ou pas –, c’est que j’ai digéré avec bien plus d’aisance mon identification ambiguë aux NEET, aux otaku, aux hikikomori… qu’aux hommes, même en envoyant la virilité aux orties. Mais je suppose qu’il vaut mieux que je ne m’aventure pas sur ce terrain – et certainement pas dans cet article de blog (ou un autre à vrai dire).
MODÈLES EN DÉRIVE
Au final, Japon, la crise des modèles est de toute façon un très bon essai, aussi instructif que passionnant. Il a peut-être aussi quelque chose de salutaire, en creusant des thématiques éventuellement envisagées ailleurs, mais de manière trop superficielle – assurément, nos représentations du Japon en France sont le plus souvent biaisées et caricaturales, qu’elles soient laudatives ou critiques. Gratter l’écorce des gyaru pour littéralement ne pas s’en tenir à la superficialité, c’est peu dire que cela fait sens. Et c’est matière à réflexion, éventuellement au-delà du seul cas japonais.
Par ailleurs, le contenu précis de cette étude a aussi pour intérêt de contextualiser des œuvres japonaises contemporaines qui, prises isolément, peuvent échapper au lecteur français, en partie sinon en tout – cela vaut pour les romans de Murakami Ryû, auteur régulièrement cité par Muriel Jolivet, mais aussi au-delà, en littérature (je pense par exemple à Sin semillas et Nipponia nippon d’Abe Kazushige) ou d’autres médias, films, anime (Perfect Blue de Kon Satoshi, peut-être ?), mangas, drama, jeux vidéo, que sais-je encore…
J’avouerai, cependant, que, disons, la première moitié de l’essai, focalisée sur la jeunesse, m’a davantage intéressé que la seconde, au liant qui m’a semble parfois plus indécis – en fait, c’est ce liant et rien d’autre qui m’a paru problématique : les développements concernant les femmes japonaises, le travail, le mariage, etc., sont très convaincants dans l’ensemble – et peut-être à compléter, par exemple donc avec Japonaises, la révolution douce, d’Anne Garrigue, dont je vous parlerai sous peu.
À lire, donc.