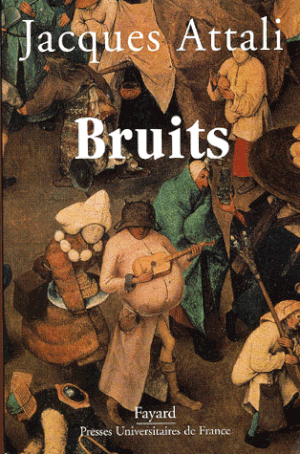Faire fi de l’opinion qu’on peut avoir de quelqu’un est essentiel à tout travail d’analyse. Dans le cas de Jacques Attali, je ne peux m’empêcher de voir l’ancien conseiller de Mitterrand monopoliser la parole ou bêtement brasser de l’air devant l’orchestre du Southbank Sinfonia – mais tâchons de ne pas évoquer l’homme médiatique, plutôt sa réflexion. Car si l’écrivain a pu réaliser son rêve à Londres, c’est qu’il est un véritable passionné de musique et qu’il possède une vraie pensée à ce sujet (quoiqu’un poil douteuse). Son texte le plus connu en la matière, c’est cet « Essai sur l’économie politique de la musique » paru en 1977 intitulé Bruits. L’auteur se garde bien de parler de philosophie dans son sous-titre, car comme certains le lui reprochent, Attali se perd parfois un peu dans sa réflexion. A mes yeux, l’essentiel de sa thèse se concentre dans les trente premières pages où il prend position vis-à-vis de la nature de l’art symbolisé par Euterpe.
Avant toute chose, il établit clairement un distinguo entre musique et bruit. La musique est du bruit façonné : le bruit se rapporte à la clameur et à la dissonance, la musique à la mélodie et l’harmonie. On pourrait reprocher à cette prise de position d’être trop classique, voire réactionnaire. Dans son essai Noise / Music: A History, le philosophe américain Paul Hegarty n’oppose pas bruit et musique mais les rassemble dans le grand domaine du champ sonore, toujours intimement liés (ce qui paraît plus juste ne serait-ce qu’à l’adresse de la musique concrète). Cependant, toute la réflexion d’Attali repose sur la musique comme manifestation naturelle et non culturelle : la musique est un moyen de distraction ou de dépassement, tandis que le bruit est un signal sonore animal qui définit la propriété, une communication primaire nécessaire à la survie. C’est donc une concession terminologique du « bruit » dans le sens de « signal » qu’il faut effectuer de prime abord.
La thèse de Bruits, c’est qu’il n’y a pas de pouvoir sans contrôle des bruits. Musique et bruits assurent la constitution d’une communauté, au-delà de la simple survie, et cette organisation sociale peut être surveillée sur un plan strictement politique. En temps de révolte comme en dictature, il faut tout écouter. « Tout savoir est le fantasme des puissants. Tout enregistrer est le rêve des polices. » Attali illustre ce fantasme par le concept du Palais des Merveilles de Leibniz, où tout s’entend sans être vu – pas si éloigné, en fait, du panoptisme dont parle Foucault dans Surveiller et punir deux ans plus tôt. De nos jours, Google et Facebook entrent sans problème dans cette catégorie de puissants qui mémorisent et enregistrent tout. Mais en politique pure, le paroxysme est atteint dans les états totalitaires où tout doit converger vers une seule personne ; or l’écoute de certaines œuvres peut éloigner le peuple des dogmes politiques. Une forme de « xénophobie musicale » qu’on retrouve dans la monarchie française ou en URSS.
Comment lui donner tort ? Toute mécanique ou stratégie de pouvoir implique ce rapport de forces, fait de contrôles plus ou moins rigoureux. Les régimes totalitaires l’illustrent parfaitement par exacerbation. En Corée du Nord, on retransmet des marches militaires dans les transports en commun pour assurer la domination idéologique, dans les usines pour booster la production ; le chef suprême anéantit toute liberté de composition savante ou tout accès à la musique populaire étrangère. De la même manière, il suffit de revenir aux évènements de mai 68 pour voir comment politique et musique sont liés : free jazz, expérimentations diverses, diatribes libertaires et chants ouvriers soutiennent une nouvelle fois cette idée, avec une dimension économique. C’est d’ailleurs l’aspect sur lequel va s’attarder Jacques Attali, en spécialiste de la matière.
Bien sûr, le pouvoir s’exerce à travers l’économie, en dehors du cadre purement légal. Le désir de contrôle est tout aussi présent, mais se fait plus subtil : le musicien doit être réduit à un objet de consommation. Toute musique entreprise dans un cadre institutionnel, ayant pour objectif la vente, n’a pas le même impact qu’une musique « libre ». Une réflexion similaire à la « ratio commerciale » de Theodor W. Adorno, dans Philosophie de la nouvelle musique… qui là encore s’exprime à fond dans l’idée de musique d’ascenseur, endroit pourtant isolé mais qui n’échappe pas à la standardisation. L’occasion pour l’auteur de fustiger le manque de remise en question de cette exploitation systémique de la musique. Illusions, apparences : les puissants instrumentalisent pour nous « empêcher de parler et d’agir sérieusement. » Seulement, on a vraiment l’impression qu’en l’espace de quelques lignes, Attali ne fait que reprendre ce qui a déjà été dit par d’autres avant lui.
Dans un second temps, il essaie de définir la musique en admettant la vanité de la démarche. On le sent sur un terrain glissant… Devant le manque de textes portant alors sur le sujet, il semble être en accord avec la définition de l’Académicien Michel Serres : « simplicité limite des signaux, message limite, mode chiffré de communication des universaux ». Jusqu’à renouveler son erreur en précisant qu’ici, on oublie le caractère « divertissant » de la musique : point de vue hautement discutable s’il en est. On ne peut pas dire que le sérialisme de Schoenberg soit particulièrement rigolo, que la musique spectrale puisse passer à la radio ou qu’on fredonne sous la douche le dernier CD de Masami Akita ! Le plus étonnant, c’est qu’après avoir parlé de la tridimensionnalité de toute œuvre humaine (information, matière, temps), Attali concède tout de même que la musique est un art comme les autres, s’exprimant sur tous les plans et à travers toutes les émotions. Tant pis pour le divertissement ?
Puisque la musique n’est pas définissable, il suggère d’en comprendre le fonctionnement, en commençant par celui qui en est à l’origine : le musicien. Selon sa place dans l’économie du pouvoir, le musicien parle sur et contre la société, il peut la critiquer ou s’en faire le porte-parole selon son niveau d’intégration sociale. Son message, par contre, peut rester « dangereux, subversif, inquiétant, libérateur », sujet à la censure. Déplorant à nouveau que d’autres essais n’existent pas à ce sujet, il cite alors Roland Barthes et cherche à montrer la largeur de sa vision en affirmant que de J.S. Bach à John Cage, l’idéologie importe peu. Est-ce dans le but de gagner le cœur du lecteur instruit ? Pas impossible, d’autant plus qu’il dresse ensuite une liste des penseurs à avoir tenté de catégoriser le quatrième art : Aristote, Spengler, Freud et Adorno, lequel est pour lui « l’indépassable sociologue de la musique ». On l’avait compris.
Attali reprend vraiment la plume en critiquant ouvertement la tradition musicologique qui veut donner un sens progressiste à l’évolution de la musique : primitive, classique puis moderne. Un bon point qui paraît évident aujourd’hui, tant il fut un cheval de bataille pour l’ethnologie ou l’histoire de l’art. De telles idées n’ont plus court chez les intellectuels de notre temps. Dès les années 60, la musique traditionnelle retrouvait sa place dans des disques largement distribués (folklore américain, français, hongrois, grec, etc.) tandis que le nomadisme virtuel et la redécouverte des musiques anciennes semblent maintenant une évidence. L’économiste clame par la suite que c’est peine perdue de créer un vocabulaire de genres, comme le font souvent les critiques, à cause de la « dimension labyrinthique » de la musique. C’est tout à fait défendable, même si ce jargon se développe de plus en plus en sous-catégories toujours plus précises et vaut plus comme indice que définition.
Mais pourquoi le natif d’Alger persiste à écrire sur la musique dans un ouvrage intitulé Bruits ? Il nous parle de « transe au-delà de la dissonance », de cartographie musicale pour évoquer les courants divers, le ruissellement des styles, un art indomptable, en perpétuel mouvement : bref, le principe de flux héraclitéen, mais dans quel but ? Peut-être simplement pour opposer ce caractère un peu immatériel de la musique à la matérialité de l’économie politique. Enfin une bonne idée de Jacques Attali : par nature, elle n’est pas adaptée au langage des « signes », qui lui n’est pas assez clair ni basique. C’est vrai. Pour preuve, l’exercice de la mercatique tend à tout vouloir catégoriser, simplifier, ramifier. Le marketing, c’est aussi l’art d’avoir un discours sans ambiguïté pour toucher une cible, et je crois personnellement que cette vision s’étend à toute communication entre individus. La musique est un langage universel, certes ; mais au XXIe siècle, reste à savoir si complexité est vraiment synonyme de dialogue social. En d’autres termes, le vrai « bruit » ne serait-il pas plutôt l’univocité que chacun s’impose pour être mieux compris par ses pairs ?