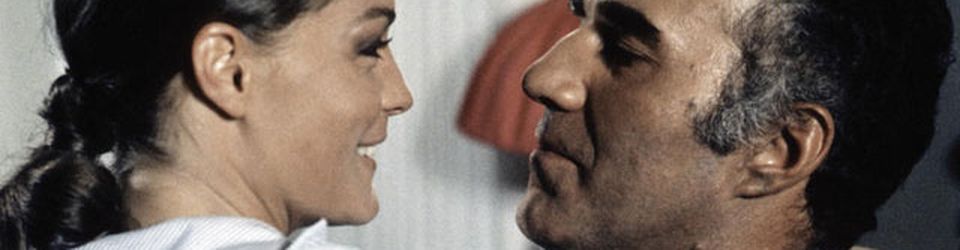Claude Sautet, cinéaste mélancolique
À noter que je donne ici mon interprétation et que la subjectivité est souveraine au sein de mes analyses. Si je rédige ces commentaires, c’est que je me dis qu’à chaque nouvelle analyse d’un film, on parvient un peu plus à se rapprocher d’une compréhension collective totale.
Liste de 8 films
créee il y a plus de 3 ans · modifiée il y a plus de 2 ans
Classe tous risques (1960)
1 h 50 min. Sortie : 10 avril 1960. Policier, Drame, Romance
Film de Claude Sautet
Émile Frève a mis 8/10.
Annotation :
Sautet, avec une émouvante sensibilité, filme le mouvement des foules, le va-et-vient de la masse qui noie et désindividualise les êtres qui s’y mêlent; l’intrigue de Classe tous risques naîtra et s’achèvera au cœur des cortèges urbains de Paris, revêtant l’allure d’une chronique réaliste, d’un morceau de vérité prélevé à même un boulevard de faux-semblants. La noirceur des désillusions, la violence d’un passé qui s’est érodé au fil des années et la détresse d’un homme épuisé, avalé par son devoir, constituent les racines du récit que tricote Sautet, s’intéressant pour sa première œuvre aux existences malades, aux histoires mourantes, condamnées dès la première image (thème qu’il explorera obstinément dans chacune de ses créations). C’est avec une finesse scénographique fascinante que le metteur en scène façonne les portraits, saisissants de vérité, de deux voyous ordinaires qui, l’un par amour pour ses enfants, l’autre par affection pour son complice, vont parier leur avenir : les regards qu’ils échangent, gorgés d’humanité, offrent parmi les plus touchantes manifestations d’amour, les acteurs se dépouillant peu à peu, défaisant leur carapace pour nous laisser entrevoir la douceur de leurs émotions. Le bouleversant drame humain composé se surmonte d’une démarche formelle inébranlable : l’utilisation protéiforme d’une narration en off, employée dans le but de servir l’humanité du propos mais également de faire progresser (en explicitant certaines zones d’ombre) le développement dramatique, la profondeur des images où sont brillamment manipulées les notions d’avant-plan et d’arrière-plan, la précision et l’intelligence des dialogues, les angles et positionnement de caméra millimétrés et le maniement magistral du silence témoignent d’une rigueur maniaque chez Claude Sautet, d’une orchestration parfaitement dosée entre motifs narratifs et intentions esthétiques. Hantée par les paradoxes, l’histoire de gangsters à la bonne conscience qu’est Classe tous risques permet à son réalisateur d’ébaucher une première peinture sentimentale, de subvertir un genre (le film noir) régi par une farandole de codes stricts et prônant l’hermétisme émotionnel des protagonistes : l’exécution, admirable, imprègne d’une humble tendresse cette œuvre d’où s’échappe à petits coups une poésie effeuillée, bouleversante trace d’humanité.
Les Choses de la vie (1970)
1 h 29 min. Sortie : 13 mars 1970. Drame, Romance
Film de Claude Sautet
Émile Frève a mis 9/10.
Annotation :
Film composé de souvenirs, à l’image d’un album photo qu’on feuillette, Les choses de la vie dépeint l’amour au passé, au présent et au futur. Pierre remet en question son avenir avec Hélène, il repense à sa vie d’avant, lorsqu’il était véritablement heureux. Ce que Pierre ne sait point, c’est qu’il est toujours plus facile de chérir une réminiscence que d’apprécier l’instant présent. Ainsi, deux couleurs s’imposeront tout au long du film, le bleu et le rouge. Contradictoires, elles seront Pierre et Hélène, passion et douleur, bienveillance et incompréhension. Elles iront même jusqu’à hanter Pierre, le ramenant constamment à cet amour qui se meurt pour cause de son immobilisme. Des dialogues crus de vérité, des acteurs témoignant d’une retenue brillante et une humanité sans nom (particulièrement dans la scène de fin) font de Les choses de la vie une grande œuvre touchante. Jamais les petites choses de la vie n’ont été si bien racontées au cinéma.
Max et les Ferrailleurs (1971)
1 h 52 min. Sortie : 17 février 1971. Policier, Drame, Romance
Film de Claude Sautet
Émile Frève a mis 9/10.
Annotation :
Frustré par un braquage qu’il n’a su prévoir, Max décide d’en provoquer un afin d’être cette fois-ci maître des évènements. Il fera commettre à des ferrailleurs un braquage des plus dangereux simplement par sa force de suggestion. Pour ce faire, il se liera d’amitié avec Lili, une travailleuse du sexe très proche d’un membre de la bande des ferrailleurs, et l’encouragera à s'ambitionner. Seulement, lorsque son désir égoïste d’empêcher un braquage se mêle à son amour (inopportun) pour Lili, Max réalise enfin l’horreur de ses actes et est empli de remords. Car qui, dans cette affaire, est réellement coupable si ce n’est celui qui l’a amorcée? Malheureusement, ce ne sont jamais les coupables qui sont arrêtés, mais bien ceux qui semblent l’être le plus : Lili devient donc la suspecte principale après l’échec du braquage. Incapable de vivre avec l’idée qu’elle ira en prison (et qu’elle le méprise), Max lui déclare sa flamme : il fusille le commissaire de police. Peut-être ainsi lui prouvera-t-il que son amour pour elle était bien réel? Dans Max et les ferrailleurs, Sautet retourne à une primarité des sentiments humains touchante mise en couleurs à l’image par le bleu, le jaune et le rouge des décors. Les dialogues écrits en collaboration avec Jean-Loup Dabadie prouvent au spectateur pour la énième fois que les films de Sautet sont avant tout des œuvres dotées d’un magnifique lyrisme.
César et Rosalie (1972)
1 h 51 min. Sortie : 27 octobre 1972. Drame, Romance
Film de Claude Sautet
Émile Frève a mis 8/10.
Annotation :
Partageant sa vie avec César, un ferrailleur homme d’affaires, Rosalie vit une vie libre de tout lien matrimonial. Toutefois, Rosalie n’est pas dupe, César est loin d’être parfait : colérique, arrogant et jaloux sont quelques-uns de ses nombreux défauts. Mais l’amour qu’il a pour Rosalie est incommensurable et il mourrait certainement si elle l’abandonnait. Seulement, lorsque David, l’ancienne flamme de Rosalie volatilisée depuis maintes années, ressurgit dans la vie du couple, un vide se crée au sein de la jeune femme. Soudain, un besoin irrépressible de reprendre cette idylle abandonnée s’empare d’elle et l’oblige à risquer son couple et tout ce qu’elle a bâti autour. À coups de répliques fortes et assurées, les trois personnages se définissent, se découvrent et se disputent leur amour. Les péripéties s’enchaînent où amour et amitié fusionnent pour mieux imploser : Rosalie quitte César, César revient, David repart, César rattrape David, César et David reviennent, Rosalie part (pour de bon). Malheureusement, l’amalgame des trois est impossible : vouloir deux personnes aux caractères diamétralement opposés relève de la chimère, tout comme est impensable le mélange des trois couleurs primaires (prédominantes dans le film). Ainsi, Sautet recrée un Jules et Jim dix ans après le film de Truffaut, mais le rend plus réel, moins enfantin et moins désinvolte, il y construit un récit déchirant où il affirme son talent sans pareil de dialoguiste.
Vincent, François, Paul et les autres... (1974)
1 h 58 min. Sortie : 20 octobre 1974. Drame
Film de Claude Sautet
Émile Frève a mis 8/10 et a écrit une critique.
Annotation :
Et défilent au ralenti des souvenirs teintés d’un bleu mélancolique, l’image d’une foule animée introduisant, tout en valsant allègrement, la galerie de personnages désassemblés sur laquelle se fixera l’œil aiguisé de Claude Sautet, grand manitou des relations humaines : à l’image du triste tableau qu’offre la vision répétée d’un téléphone affalé sur son support, le metteur en scène encapsule avec une crudité inouïe les tragiques trajectoires de ses quatre protagonistes où se superposent désœuvrement, désespoir et faillibilité. S’achevant sur l’acceptation (par les quatre protagonistes) de la médiocrité de leur condition, inchangée mais dorénavant reconnue et comprise, l’œuvre compose un bouleversant message qui éloigne à jamais la romance de Sautet, mettant en évidence l’incapacité humaine et la tristesse de l’éternel recommencement : on en ressort acculés à la détresse de ces âmes malaisées, dévorés par l’agressivité de Piccoli, le spleen de Depardieu, l’accablement de Montand, les affres de Reggiani. (Extrait de ma critique.)
Pour un avis plus étoffé, voir ma critique.
Une histoire simple (1978)
1 h 47 min. Sortie : 22 novembre 1978. Drame, Romance
Film de Claude Sautet
Émile Frève a mis 8/10.
Annotation :
Tout est dans le titre. Une histoire simple. Voilà ce que c’est. Le film n’aspire à aucune autre prétention que celle de conter une histoire, une histoire comme une autre. Dénué de la moindre tentative d’épater, Une histoire simple raconte, à travers sa mise en scène simple et naturelle, la vie de Marie, femme libre hantée par ses contradictions (qui ne l’est pas?). Entre amitié et amour, elle navigue et tente de vivre selon ses envies. Abordant des thématiques telles que l’avortement et le suicide de façon décomplexée, Sautet dirige la caméra avec une précision redoutable : chaque mouvement est effectué dans l’optique de garantir au spectateur une immersion complète dans le quotidien de Marie. Absolument touchant, tout le génie du film pourrait se résumer dans une scène des plus normales où, sur le visage de Marie (Romy Schneider), on voit se dessiner l’assurance et la fierté d’une femme libre, emplie de joie et belle à en mourir. Ici, l’image pourtant si impersonnelle acquiert une poésie indicible. Un bref moment de grâce surgit, éphémère, et chamboule le spectateur. S’amusant à imager par le contraste les sentiments de ses personnages : pour illustrer la solitude, il place son personnage dans un bar bondé de gens, Sautet prouve encore une fois sa contemporanéité en signant un film profondément féministe ayant comme principal sujet la sororité.
Un cœur en hiver (1992)
1 h 45 min. Sortie : 2 septembre 1992. Drame, Romance
Film de Claude Sautet
Émile Frève a mis 9/10.
Annotation :
Maintes années se sont écoulées depuis les débuts au cinéma de Claude Sautet. Le temps a fait son œuvre. Celui qui avait pour habitude d’écrire des intrigues vives dotées de dialogues coup-de-poing s’est définitivement assagi lors de la conception d’Un cœur en hiver. La mise en scène et la photographie ont, elles aussi, emboité le pas en se libérant de tout artifice superfétatoire. À l’image dénudée, presque pluvieuse, le film suit la vie simple (et monotone) de Stéphane, un luthier anormalement effacé, qui, malgré lui, va s’attacher à la compagne de son patron, Camille. L’immobilisme du cœur de Stéphane va rapidement être troublé sans que jamais il ne veuille l’admettre. Hanté par la peur de vieillir et de voir les autres vieillir, il tentera par tous les moyens de refouler son amour pour la violoniste allant même jusqu’à afficher un certain mépris à son égard. Tout comme le luthier, Sautet est tourmenté : il s’inquiète à savoir si son film touchera ceux qui iront le voir ou si, au contraire, son cinéma est devenu désuet (questionnement présent dans la scène du souper au début du film). Tout à fait troublant, Daniel Auteuil signe une performance d’une sincérité désarmante où la fausse simplicité du personnage émeut inévitablement le spectateur.
Nelly et Mr. Arnaud (1995)
1 h 46 min. Sortie : 18 octobre 1995 (France). Drame
Film de Claude Sautet
Émile Frève a mis 7/10.
Annotation :
Dans ce dernier film de Claude Sautet, tout est un peu plus calme, un peu plus morne, même les couleurs primaires de ses films ont disparu au profit d’un vert bien triste. Ici, les amours sont dysfonctionnels et ne durent pas. Le seul amour vrai et fort est celui qu’a Nelly pour Pierre Arnaud : un amour père-fille. L’amour que Nelly n’a jamais eu d’un père et celui que monsieur Arnaud n’a jamais eu de sa fille leur est enfin donné. Film-testament et autobiographique, le récit avance doucement, valse d’une scène à l’autre, contemple sa propre lenteur. Là où Un cœur en hiver était une tentative pour Sautet de parler aux spectateurs, Nelly et Monsieur Arnaud est un film qu’il écrit et réalise pour lui et lui seul. Et c’est peut-être pour ça que malgré ses très belles qualités, il ne réussit pas à émouvoir le spectateur comme il avait fait pour son précédent film. Tout en pureté, Sautet clôt une filmographie haute en couleur par une monochromie presque déprimante où vieillesse et jeunesse se côtoient comme deux amis de longue date.