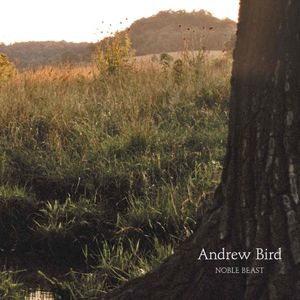On le serine à chaque nouvelle sortie : ce Bird-là chante sur sa branche et il faut aller le chercher. Le sifflement qui ouvre Oh no pourrait être une marque de fabrique, un code, on ne voit pas venir le jour où il pourrait lasser. Pourtant l'oiseau n'a pas encore marqué les esprits. La faute à quoi ? Des airs d'exception disséminés sur trop d'albums épars, parfois sur des EP de transition ? On aimerait dire : aide-nous, précieux, sinueux Andrew, et viens nous enchanter juste un peu plus près du commun. Avec Fitz and the dizzy spells, on y est presque. Effigy, c'est trop beau et c'est vrai : un tempo valsé au tracé mélodique irrésistible et cette phrase, « fake conversations on a non-existent telephone », tournure insolite à la Bird. Ici la rime à « telephone » est « too much time alone » : depuis trop longtemps seul, c'est précisément ce qu'on peut se dire à propos de l'auteur. Non que sa présence ne suffise à meubler une scène, avec juste guitares à portée de main, violon, pédales d'effets... Et puis quand il plane aussi haut, on peine à lui trouver des pairs. Pudeur déplacée : Bird enchaîne avec un milieu d'album en dents de scie. On revoit la lumière avec les splendides The Privateers et Souverian. On l'aime toujours, l'oiseau, mais qu'est-ce qui nous retient de le claironner ? C'est par instants génial et globalement encore un peu raté. « Rater mieux », disait Beckett, dont ce doux prolixe est en cela l'héritier. FG
La tête couverte d’un bonnet, Andrew Bird, de passage à Amsterdam pour un concert, reçoit dans l’immense pièce glaciale qui lui sert de loge. Dans quelques heures, l’Américain, muni de son attirail d’homme-orchestre (violon, guitare, xylophone et boucles), va fouler les planches de De Duif – une salle pas tout à fait comme les autres, puisqu’il s’agit d’une église aux dimensions imposantes et à l’acoustique hors norme. Un cadre inhabituel qui, de toute évidence, séduit Bird, ravi à l’idée d’échapper à la routine du circuit rock. "J’arrive tout juste de Londres, où j’ai aussi joué deux soirs dans une église, dit-il. L’expérience a été intense, tant sur le plan du rendu sonore et de l’exécution que de l’écoute. J’ai besoin de ce genre de défis pour me sentir pleinement engagé dans l’acte musical." Ces dernières années, on avait croisé brièvement Andrew Bird ici et là, dans les coulisses de festivals et de concerts calés au milieu d’interminables tournées. Visiblement atteint par ces cadences infernales, il avait l’air ailleurs, le regard embrumé par la fatigue. Mais en cette après-midi de novembre, on le retrouve tel qu’il était en 2004, quand il avait débarqué auréolé d’un chef-d’œuvre de songwriting, le toujours inépuisable Weather Systems. Réservé mais attentif, pesant chaque mot et chaque silence, il s’exprime à nouveau avec cette intensité d’expression et ce souci de justesse qui caractérisent aussi sa musique. Un peu émoussé dans son précédent album Armchair Apocrypha, dont le son musclé ne masquait pas des carences d’écriture, Bird a repris du poil de la bête. Dans Noble Beast, son dernier-né, il a récupéré cette foulée légère, ce geste gracieux et cette voix ailée qui avaient accompagné ses premiers pas en solo. Un regain de forme dont lui-même avoue être quelque peu surpris. "En mars 2008, j’ai terminé ma tournée sur les rotules et j’avais prévu de m’offrir un break, raconte-t-il. Mais ma tête fourmillait d’idées auxquelles j’étais impatient de me frotter. Je pensais louer une cabane dans les Rocheuses, puis enregistrer à la coule en faisant pour la première fois appel à un producteur. Mais ça n’a pas du tout été dans ce sens. Les gars de Wilco m’ont prêté leur loft de Chicago. Là, j’ai enregistré les bases de nouveaux morceaux avec une frénésie incroyable. J’en suis sorti dans un état second, comme un type qui serait parti se cuiter pendant une semaine et ne se souviendrait plus trop de ce qu’il a fait." L’ivresse dans laquelle Bird a baigné n’a pourtant pas affecté sa clairvoyance. Décapées de tout enrobage inutile, laissant souvent la part belle à l’acoustique (guitare, violon, piano…), ses nouvelles chansons renouent avec les lignes mélodiques pures et les textures instrumentales nuageuses de Weather Systems. Comme à l’époque de son premier album, l’Américain a d’ailleurs souhaité finaliser Noble Beast à Nashville, avec la complicité du génial Mark Nevers – le chef-opérateur attitré de Lambchop, équipé de l’une des plus belles paires d'oreilles de l’Ouest. "De tous les disques que j’ai réalisés, Weather Systems reste mon préféré, confie le chanteur. J’aime sa cohérence, sa matière sonore presque gazeuse : la voix et le violon semblent flotter au-dessus des mélodies. Mais c’était un disque était assez court, j’avais l’impression de ne pas avoir creusé ce sillon jusqu’au bout. Pour Noble Beast, j’avais une idée précise du son boisé et naturel que je voulais entendre, et Mark était le seul à pouvoir m’aider à la concrétiser. Je pensais à la ferme où j’habite, et notamment à cette époque où le printemps prend soudain toutes les collines et les arbres alentour, où il y a de la mousse et du vert partout…" Il souffle effectivement une brise vivifiante sur les chansons et dans la voix – plus souveraine que jamais – d’Andrew Bird, qui semble goûter à nouveau au plaisir de plonger corps et âme dans l’onde claire de la musique. Noble Beast conte l’histoire d’un homme qui remonte à la source originelle de son art, sans oublier pour autant tout ce qu’il a vécu et appris au fil de son parcours. Mélodies accrocheuses arrachées à la banalité des conventions pop (Oh no, Fitz & the Dizzyspells), ballades en fingerpicking survolant de très loin les terres du folk (Tenuousness, Natural Disaster), ritournelle zébrée de rythmes électroniques (Not a Robot, but a Ghost), morceaux de bravoure lyrique soustraits aux lourdeurs de l’emphase (Nomenclature, Souverian) : il n’est pas une chanson, ici, qui n’exprime pas avec force le haut niveau d’inspiration et de maturité atteint par Bird après cinq ans d’activités musicales bien remplies. Nu comme au premier jour, et riche de mille expériences : une bonne définition de ce que peut être un homme libre. (Inrocks)
Je n’écris que pour être relu” affirmait André Gide. Les disques d’Andrew Bird, quant à eux, ne semblent être conçus que pour être réécoutés. Pour être honnête, c’est avec un enthousiasme modéré qu’on accueille à chaque nouvelle livraison les enregistrements du songwriter-chanteur-violoniste-siffleur. Pâlots en comparaison des époustouflantes prestations scéniques du Chicagoan, ternis par le caractère un peu prévisible des partis-pris de production (le traditionnel traitement folk, organique et patiné), les disques de l’Oiseau suscitent rarement le coup de foudre, ni même l’étonnement, ce qui ne les empêche pas de se révéler excellents. Car bien souvent, après plusieurs semaines d’apprivoisement, les chansons de l’homme-orchestre finissent par libérer leurs arômes, livrer quelque détail inattendu et dévoiler leur singulière consistance. Fluide malgré sa complexité, savant en dépit de ses habits pop, tout le travail d’Andrew Bird repose sur cette dualité, ce goût pour l’oxymore que trahit d’ailleurs le titre de Noble Beast. Tiraillé entre la désarmante beauté de la nature, les vertus de la simplicité (les mélodies, sobres et contagieuses) et un bagage culturel touffu qui lui fait priser l’abscons (le lexique, souvent cryptique), Bird assume toujours ses tendances bipolaires. Le disque s’ouvre ainsi sur Oh No, ritournelle au refrain lumineux où il est question de “calcified arhythmatists” et de “harmless sociopaths”. Par un tour de passe-passe dont il détient le secret, le morceau sonne toutefois davantage comme une promenade entre amis que comme une soutenance de thèse. Dans le même ordre d’idées, Master Swarm, clé de voûte de ce onzième opus, juxtapose le dépouillement du folk rural et la luxuriance majestueuse de l’opéra. Plus loin, Not A Robot But A Ghost alterne percussions tropicalistes et segments ambient avec la même aisance. Un poil moins dense et baroque que son prédécesseur Armchair Apocrypha (2007), plus porté sur le jeu rythmique (Anonanimal et sa batterie libératrice), Noble Beast s’annonce comme un excellent cru, long en bouche, qu’on pourra une fois encore garder en cave sans craindre que le nectar ne tourne au vinaigre. (Magic)
Inutile d'essayer de recenser la prolifique discographie d'Andrew Bird. Entre les albums studio et les lives (dont la série des "Fingerlings"), on atteint au moins la quinzaine, déjà. Et voilà que l'Américain nous sort l'édition limitée ET l'édition Deluxe, de son nouvel album – cette dernière nous gratifie d'un CD supplémentaire d'instrumentaux. Bien, on a compris qu'Andrew Bird était un multi-instrumentiste hors pair (surtout depuis "The Mysterious Production of Eggs") et un mélodiste doué (surtout depuis "Weather Systems"). C'est en gros ce que vient confirmer le deuxième disque de l'édition Deluxe, intitulé "Useless Creatures". On est en droit de se demander quel degré d'ironie est contenu dans ce sous-titre, tant ces neuf créatures inutiles participent tantôt de l'anecdotique, tantôt de la démonstration de virtuosité semi-improvisée à la loop station – globalement les longues dérives instrumentales s'écoutent d'une oreille, sans déplaisir, mais sans émerveillement ; il faut croire que l'absence de la voix magistrale de Bird se fait ressentir. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien "Noble Beast", ses douze titres et ses deux interludes. Et à cet égard, l'élégance toute British du gentleman farmer de la pop se voit à nouveau confirmée. Attention, pas confirmée comme "Armchair Apocrypha" avait confirmé le précédent album, à grands renforts de virtuosité déchaînée : Bird use moins de la déflagration sonore ; point de "Nervous Tic Motion of the Head to the Left" sur "Noble Beast", ni de boucles développées à l'envi. Il revient ici aux fondamentaux qui font de lui un artiste important : les arrangements mélodiques ; et ceux-ci sont empreints d'une telle légèreté, d'une telle inventivité aussi, que l'album s'autorise à ne déployer que des recettes déjà largement éprouvées sur les précédents albums ; c'est ainsi qu'un coup d'archet par-ci, une trille sifflée par-là, viennent régulièrement ponctuer les morceaux, tandis que des guitares un peu plus nerveuses, des rythmiques denses à tendance électro ("Not a Robot, But a Ghost") réveillent subtilement la fin de l'album, évoquant même une pop rock lyrique à la Radiohead des débuts, eh oui. On aurait pu craindre, après une carrière aussi dense, qu'Andrew Bird nous laisse admiratifs, tout respectueux de sa virtuosité, mais quelque peu résignés sur sa capacité à nous émerveiller encore – sentiment paradoxal que m'avait laissé son dernier concert lillois. A l'écoute de "Oh No", ballade folk pop introductive dont on se demande si c'est l'évidence ou la complexité qui est la plus prégnante, on a clairement à faire à un tube de sunshine pop, à la "Mellow Yellow". Bonheur suprême : tout l'album est du même tonneau, à la fois apaisé et énergique, alternant dense légèreté et gravité éthérée, tout traversé qu'il est de fulgurances mélodiques - notamment de virages en mineur superbement mis en valeur par leur rareté même. Les ballades amples ("Souverian") succèdent aux morceaux de bravoure rock ("Anonimal"), dans une unité de style, et de maîtrise, plus que de ton. C'est sans doute ce que l'on appelle l'inspiration.D'aucuns pourraient qualifier ce "Noble Beast" de variations sur le même thème, ou sur le même style – celui qui a fait la réputation de l'Américain - mais force est d'avouer qu'Andrew Bird est passé tellement maître en son domaine qu'il laisse l'auditeur comblé.(Popnews)
Andrew Bird est de nature discrète, voire timide, mais on ne va pas lui en faire le reproche. Ce trait de caractère se ressent dans sa musique, et les aficionados de premier ordre l’apprécient d’autant plus pour son talent et son humilité. Retranché depuis son avant-dernier album (« Armchair Apocrypha ») sur ses terres de l’Illinois profond, il cultive son jardin musical, loin des modes et des hypes insignifiantes. Mais ce « Noble Beast », on l’attend avec fébrilité, avec tout de même un avant-goût de déjà-vu, tellement Andrew Bird nous a habitué à user de la même formule à longueur d’albums.A l’écoute de Oh no, on n’est pas dépaysé, ce morceau reflétant à merveille la Bird’s touch. Tout y est, la voix sifflotante, une mélodie entraînante mais jamais idiote, et même le fidèle violon est de la partie. Ok, bon alors passons aux morceaux suivants. Le très beau Masterswarm permet néanmoins à Andrew Bird de chanter merveilleusement bien, et c’est déjà ça de gagné. C’est alors qu’intervient Fitz And Dizzy Spells, et c’est là que ça se complique. Bon d’accord c’est un chouette morceau, mais pas révolutionnaire non plus, car un peu trop optimiste, voire facile. On zappe le plan-plan Effigy, pour s’attarder sur Tenuousness, avec ses cordes de violon pincées, qui instaurent un rythme particulier au morceau. Mais c’est quand on n’en peut déjà plus, et que l’on a l’impression de tourner en rond, qu’apparaît en milieu d’album, Not A Robot, But a Ghost, super morceau à la texture synthétique, et l’on se prend à rêver d’entendre un jour un album d’Andrew Bird entièrement voué à l’électronica, comme a su le faire Merz avec classe à ses débuts. Anonanimal est certes aussi un morceau intéressant, avec encore une fois le violon au premier plan. Mais hélas le morceau perd de son charme en cours de route, trop banal. La suite de l’album est constellée de belles ballades (Privateers, Souverian), on ne va pas s’en plaindre, mais bon voilà on s’ennuie. Surtout que l’album souffre de sa longueur, c’est bien dommage. Ce qu’Andrew Bird avait réussi sur « Armchair Apocrypha », avec ses morceaux plus accrocheurs, il le perd ici en voulant revenir aux fondamentaux. On est peut-être des auditeurs exigeants, mais on attend encore un peu de culot de la part d’Andrew Bird, qu’il nous surprenne un jour en changeant radicalement de cap. On sera alors aux premières loges, promis juré. (indiepoprock)